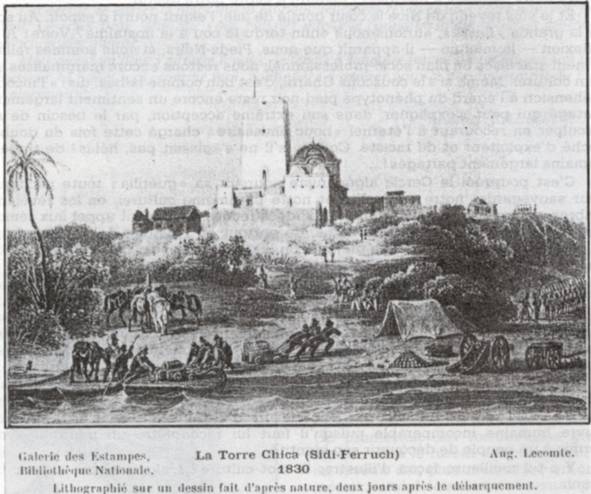
La Torre Chica (Sidi-Ferruch)
1830
HISTOIRE
14 juin 1830. - Objectif : Alger
par Gaston PALISSER
(Suite)..(note du site: je ne possède
pas le n° précédent.Donc, c'est la suite de rien. Vous
prenez le train en marche. Attention de ne pas la rater, la marche!)
La journée du 16 juin 1830
Heures d'angoisse
ARRIVÉ devant Sidi-Ferruch, le 13
juin 1830 (1), le corps expéditionnaire français débarquait
le 14 avant l'aube et s'emparait sans grandes difficultés des positions
que les Turcs tenaient à environ 2.000 mètres du rivage.
Les trois divisions s'installaient alors sur le terrain conquis, occupant
la presqu'île ainsi que tout le théâtre situé
en avant, s'y retranchant solidement et préparant activement le
prochain bond en direction de l'objectif visé : Alger...
La journée du 15 (2) s'écoula sans incident sérieux,
occupée surtout par les troupes à
poursuivre le débarquement du pesant et volumineux matériel
de parc amené à pied œuvre, à aménager
la base arrière et à renforcer les défenses sur toutes
les lignes avancées. La nuit du 15 au 16 se passa tranquillement,
mis à part un incident sans conséquences : vers 2 heures
du matin, un cheval échappé passa au galop devant les lignes.
Quelques coups de feu éclatèrent alors, dans l'obscurité,
tirés par des sentinelles nerveuses. Réveillés en
sursaut, les hommes qui n'étaient pas de garde se précipitèrent
aussitôt sur les faisceaux et prirent les armes. Mais en silence,
cette fois, et ils attendirent les ordres. La fâcheuse et coûteuse
mésaventure de la veille (3) avait au moins enseigné à
tous, troupiers et officiers, à se garder de toute alarme irréfléchie.
Puis, l'incident éclairci et ramené à ses justes
proportions, tous ceux qui en avaient la possibilité tentèrent
de renouer avec le sommeil.
Cette nuit-là fut particulièrement fraîche et, à
l'aube, une abondante rosée mouillait les bivouacs.
Le jour se leva, gris et maussade, sans aurore, ce 16 juin. Le soleil
se dérobait derrière de sombres nuées, mais la chaleur
était déjà accablante. La veille au soir, le baromètre
avait indiqué 746 mm de pression. Tout semblait présager
un grain sérieux. Un témoin nous dit (4) : "Le soleil
s'est levé aujourd'hui à travers de gros nuages qui se détachent
sur le ciel par masses énormes ; leurs bords, d'un éclat
plus vif que celui de l'argent le mieux bruni, ressortent sur un fond
gris de tempête; l'atmosphère est lourde et étouffante,
tout annonce un orage. Je descends vers la plage pour y chercher un peu
de fraîcheur ; une inquiétude vague y règne ; les
marins sont soucieux et tournent constamment leurs regards vers le ciel...".
De bonne heure pourtant, les Barbaresques s'étaient approchés
des lignes et avaient recommencé leurs habituels harcèlements
des avant-postes. Partout, des petits combats s'étaient livrés.
Le général de La Hitte (5) avait envoyé de nouvelles
pièces d'artillerie légère vers les lignes, y ajoutant
même trois vieux canons de fer pris aux Turcs dans la matinée
du 14. Intervention qui soulagea l'infanterie, lui permettant aussi d'économiser
ses munitions dont elle avait fait la veille une consommation exagérée.
Et pendant ce temps, sans relâche, les marins continuaient le débarquement
des vivres, du matériel et des munitions commencé avec les
premières lueurs du jour. Sentant venir le grain proche, ils se
hâtaient d'atterrir, de détacher leurs embarcations et de
repartir vers les bâtiments pourvoyeurs. Leurs cris et leurs appels
rompaient seuls le silence oppressant qui pesait sur le paysage. A bord
des vaisseaux, les officiers assuraient les ancres, faisaient doubler
les amarres et soulager les mâtures ; le gros des navires les plus
proches du rivage s'appuyaient mutuellement par des grelins doublant les
câbles.
La tempête
Vers 8 heures, une sorte de chape gris- plombé
enveloppa progressivement l'atmosphère et le limbe livide de ces
vastes nuées s'arrêta sur les sommets qui dominaient le camp.
Puis, très vite, une succession de vapeurs plus sombres, épaisses,
fuyantes et déjà déchirées par la foudre,
envahit le ciel, accompagnée des grondements de plus en plus puissants
du tonnerre.
Le vent s'était levé du nord-ouest, tout de suite furieux,
déchaîné, poussant de lourdes masses d'un noir d'encre
vers la terre, des nuages de pluie. De gigantesques éclairs en
zigzags zébraient la voûte céleste qui s'obscurcissait
profondément et des gouttes d'eau, rares, mais d'une extraordinaire
grosseur, se mirent à tomber, signe avant-coureur d'une violente
tempête, dans ces contrées. Elles étaient si lourdes
qu'elles soulevaient de minuscules nuages de poussière lorsqu'elles
touchaient terre.
Du large, l'ouragan accourait, au paroxysme de la colère déjà,
faisant passer sur la mer, par intermittence, de courtes et puissantes
rafales qui soulevaient de formidables vagues. Vers 8 h 30, la pluie s'abattit
soudain, diluvienne. Elle arrivait par nappes, noyant le camp, la campagne
et les collines environnantes qui disparaissaient complètement
derrière les trombes d'eau chassées par les vents furieux.
La force de la tempête était telle que le haut et svelte
dattier qui s'élevait près de la plage courbait son fût
élancé jusqu'à la limite du supportable, son bouquet
de palmes vertes échevelées fouettant sans relâche
le mur de l'eau. De gros buissons, des touffes d'agaves hérissés
de pointes, brutalement arrachés, roulaient en tous sens sur le
sol ruisselant comme des fétus de paille. Partout des arbres, de
grands arbustes, gisaient à terre, déjà culbutés,
renversés d'un seul coup, dressant vers le ciel la masse boueuse
de leurs racines enchevêtrées, et ceux qui tenaient encore
debout ployaient, ondoyaient comme de simples herbes, laminés sous
la puissante pesée de l'eau et du vent conjugués.
Dès le début, le grand pavillon blanc fleurdeliséqui
flottait au sommet de la Torre Chica où était installé
le grand quartier général avait été arraché
net au ras de la hampe. Partout, les hommes en ligne s'abritaient comme
ils le pouvaient de la tempête. Mais 'durs frêles appentis
de feuillage, les fourrés sous lesquels ils se tassaient, tentant
illusoirement de se protéger des cataractes d'eau, parfois mêlée
de grêle drue et percutante, se révélaient totalement
inefficaces. Dans cette tourmente liquide, la préoccupation majeure
de tous était de conserver au sec les gibernes à poudre,
tentative bien aléatoire dans de telles conditions. Le plus grand
nombre des troupiers se résignaient à maintenir leurs couvertures
tendues au- dessus de leurs têtes, à bout de bras. Et les
rares privilégiés qui, ce matin-là, disposaient déjà
d'une tente, n'étaient guère mieux lotis : il pleuvait autant
à l'intérieur qu'au dehors, sous celles encore épargnées
par les bourrasques et, pour les hôtes de celles qui avaient été
emportées, l'ultime ressource consistait à se réfugier
sous les toiles trempées, solidement agrippées sur les bords.
A chaque instant, la foudre jaillissait du ciel bas et fuligineux, s'abattant
dans toutes les directions. Par trois fois, elle frappa des faisceaux
de fusils dressés dans les lignes, sans toutefois faire de victimes.
La virulence de l'ouragan s'accompagnait d'un fracas assourdissant : grondements
du tonnerre et des flots déchaînés, hurlements affreux
du vent, crépitement de la pluie et de la grêle, détonations
des canons d'alarme de la flotte qui se faisaient entendre sans cesse,
toutes ces voix démentes mêlées abasourdissaient les
hommes, leur faisant aussi mesurer leur propre insignifiance au milieu
des éléments en furie. Par instants, on percevait dans ce
tintamarre les hennissements aigus des chevaux, français et barbaresques,
pauvres bêtes folles de terreur dont beaucoup se couchaient, toutes
frissonnantes sur le sol détrempé.
Cependant, malgré l'angoissante situation à terre, tous
les regards de l'armée se tournaient, anxieux, vers la mer où
l'immense flotte qui portait encore dans ses flancs presque tous les moyens
de vivre et de combattre semblait en voie de perdition !
Dans la baie de l'ouest, à peine protégée de l'ouragan
par le promontoire, le spectacle était terrifiant. Jusqu'à
l'horizon, l'eau semblait fumer. D'énormes vagues roulaient, se
poussant l'une l'autre, sinistres, leur eau verdâtre soulevant avec
une puissance inouïe les vaisseaux les plus gros dont les chaînes
se tendaient jusqu'à se rompre. Effectivement, le Duquesne, vaisseau
armé en flûte (6), vit les siennes se briser comme du verre
! Sous la violence des secousses que les lames leur imprimaient, les navires
se cabraient droit sur leur quille, retombant de côté dans
des creux traîtres, dans des abîmes, chassant tous frénétiquement
sur leurs ancres qui dérapaient sur les fonds sablonneux. Beaucoup,
menacés de faire côte ou de se briser les uns sur les autres,
tiraient sans relâche du canon de détresse, au milieu des
cris d'épouvante des marins. Des lames monstrueuses, couleur de
plomb et pleines de bave, frappaient de grands coups de bélier
qui claquaient comme des décharges de la foudre contre les murailles
des bâtiments, balayant tout sur les ponts. Les creux étaient
tels qu'un navire du convoi, tirant 4 mètres d'eau et mouillé
par 8 mètres, talonna et démonta son gouvernail. C'étaient
de gros vaisseaux de guerre! Quant aux navires de commerce, plus légers
et moins solides que ceux de l'escadre, ils disparaissaient littéralement
sous les vagues, ballottés en tous sens par des montagnes d'eau,
sauvagement secoués par le vent hurlant. Plusieurs avaient déjà
été précipités sur les rocs de la presqu'île
et deux bricks marchands projetés avec une incroyable puissance
loin à l'intérieur de la plage ! Que dire alors des centaines
de petits bâtiments sillonnant la baie quelques instants auparavant,
chalands, barges, bateaux-boeufs, chaloupes, canots! Beaucoup s'étaient
déjà brisés sur les récifs ou mis en pièces
sur la grève où ils gisaient rompus, disloqués. Et
l'on voyait leurs infortunés matelots se démener sur le
rivage, acharnés à disputer à la mer écumante
les restes de leurs embarcations et les précieuses marchandises
dont elles étaient chargées. Car les lames monstrueuses,
après s'être abattues sur la plage dans un bruit de tonnerre,
se retiraient ensuite, semblables à de mini-ras de marée
qui ramenaient tout derrière eux, laissant le sol creusé,
raviné, ruisselant, proprement mis à nu.
Ce qu'il y avait de consternant aussi, dans cette effroyable tourmente,
c'était la situation dramatique des grands blessés que l'on
avait transférés, la veille et l'avant-veille, sur des bâtiments
de charge, pensant qu'ils seraient là mieux abrités et soignés
qu'à terre où tout faisait défaut encore. Allongés
sur des matelas ou de simples couvertures, certains dans des hamacs, ces
malheureux n'avaient pu être assujettis à leurs couches de
fortune. Il est facile d'imaginer la torture infligée par la tempête
à ces hommes déjà physiquement mal en point, tourmentés
par un roulis démentiel, dans les entreponts où il avaient
été déposés, roulant sans cesse les uns sur
les autres, projetés avec force contre les murailles, au milieu
des cris de souffrance, des gémissements et des appels à
l'aide. Ainsi, de la Vigogne, gabare de charge qui portait plus d'une
centaine de ces blessés et qui, ayant chassé sur ses ancres,
allait à chaque coup de mer talonner avec rage les rochers hérissant
le promontoire de Sidi Ferruch. Par deux fois, jugée perdue, elle
fut sauvée in extremis par des bâtiments à vapeur
qui la tirèrent de ces situations critiques (7). Ainsi également
de la frégate Iphigénie qui, transportant un certain nombre
de ces blessés et ancrée à proximité de la
pointe occidentale de la presqu'île (8), voulut changer de mouillage,
remorquée par un bateau à vapeur et qui manqua de périr,
déchirée par les récifs. Durant près de deux
heures, elle resta couchéeà demi, exposée aux plus
grands dangers, sans pouvoir être efficacement secourue. Situation
tout aussi alarmante pour la gabare de charge l'Astrolabe, portant elle
aussi des malades et des blessés qui faillit sombrer sur les rocs
des îlots qui prolongeaient la pointe. (9)
Tous les vaisseaux qui, menacés d'être jetés à
la côte par l'horrible tourmente et à qui leur position au
sein de l'escadre au mouillage permettait d'appareiller, l'avaient déjà
fait, dans le plus grand désordre, après avoir laissé
filer les câbles et ils tentaient, au prix d'extrêmes difficultés,
de gagner le large. Dès le début de la tempête, Duperré
leur en avait intimé. l'ordre.
De l'autre côté de la presqu'île, dans la baie de l'est,
la situation des navires mouillés là-bas était tout
aussi critique. Le Trident, vaisseau de 74 canons, armé en guerre
(10) et commandé par le contre- amiral de Rosamel (11), la Bayonnaise,
corvette de 20 canons, l'Actéon, le Dragon, le Griffon, bricks
de 20 canons et la Badine, brick de 10, étaient en perdition, tirant
sans relâche le canon de détresse. Frappés de plein
fouet par l'ouragan qui déferlait du nord-ouest, ces bâtiments
chassaient sur leurs ancres qui glissaient sur les fonds sablonneux, inexorablement
entraînés vers la côte et menacés d'échouage.
Voyant ce danger, un bataillon du 28e qui se trouvait en réserve
à la gauche de l'armée, accourut sur la plage pour les aider
dans la mesure du possible et, surtout pour les protéger. Car,
à l'horreur de la tempête s'ajoutait la menace que faisaient
peser de nombreuses bandes de Barbaresques que l'on apercevait dans le
lointain, de chaque côté du promontoire, parcourant la grève,
prêts à saisir le moment où les navires feraient naufrage
afin d'en piller les épaves et d'en massacrer les équipages.
Heureusement, les pillards en furent pour leurs mauvaises intentions.
Manœuvrant très habilement, les vaisseaux parvinrent à
se dégager à temps et à gagner le large en s'élevant
au vent, après de longues et pénibles évolutions.
Le temps s'écoulant, aucun signe d'accalmie ne se manifestait.
Au contraire, la tourmente semblait augmenter en intensité. Le
vent soutenait sa violence et la mer redoublait de fureur.
Dans le camp où l'on voyait la détresse de la flotte, la
consternation était générale. Cette perte qui paraissait
certaine allait obligatoirement entraîner celle de l'armée.
Celle-ci ne disposait que de quelques jours d'approvisionnement à
terre : la majeure partie des vivres, des munitions et du matériel
se trouvait encore à bord des navires.
Au quartier général, de Bourmont (12) paraissait soucieux,
mais non effrayé, faisant les cent pas au rez-de-chaussée
de la Torre Chica. Près de lui, le général de Tholozé
(13) semblait vivement agité : ...il ne cessait de courir à
la terrasse, nous dit un témoin (14), d'où il revenait,
répétant sans cesse avec l'accent de la douleur : C'est
un désastre, le vent ne change pas! Le général Desprez
(15) était consterné ; son habit était trempé
et, de la large visière de sa casquette, l'eau retombait en nappe.
Les bras derrière le dos et le sourcil froncé, il disait
à chaque instant : Ce sera le second tome de l'expédition
de Charles-Quint! Et ses craintes étaient partagées par
tous les officiers supérieurs... "
En effet, tous ceux qui possédaient quelques notions d'histoire
ne pouvaient s'empêcher d'établir le parallèle entre
la situation présente de l'armée française et la
position tout aussi terrible qui avait été autrefois celle
du corps expéditionnaire espagnol devant Alger, en 1451, et qui
l'avait conduit au désastre.
1541 : défaite de Charles-Quint devant Alger
Cette année-là, l'empereur
d'Allemagne et roi d'Espagne, souverain des Flandres, de l'Autriche et
des colonies d'Amérique, le potentat sur les terres de qui le soleil
ne se couche jamais, Charles-Quint, décide de s'emparer d'Alger,
à cette date seul point d'appui de l'Empire ottoman dans le bassin
occidental de la Méditerranée. Les Turcs, depuis 1533, alliés
au roi de France, François ler, sont le principal obstacle aux
projets de monarchie universelle de Charles-Quint. Se saisir d'Alger,
expulser les Turcs de l'Afrique du Nord, c'est isoler la France et la
priver désormais de tout secours de la part de ses alliés
dans sa lutte contre le monarque austro-italo-espagnol. Après la
prise d'Alger, l'armée navale et l'armée de terre devaient
être employées contre "les mauvais chrétiens
" alliés du Grand Turc...
Le 19 octobre 1541, Charles-Quint parvient devant Alger à la tête
d'un corps expéditionnaire de 22.000 hommes : 6.000 Allemands,
5.000 Italiens, 6.000 Espagnols ou Siciliens et 3.000 soldats provenant
de différents pays chrétiens ; ainsi que 1.500 cavaliers,
200 gardes de la maison augmentés de 150 chevaliers de Malte (16).
Cette armée est convoyée par une flotte de 75 galères
de combat (12.330 matelots) et 451 navires de transport, commandée
par l'illustre amiral génois Andréa Doria. Les plus fameux
capitaines de l'empire se tiennent aussi sous les ordres directs de leur
souverain.
Des vents violents contraignent d'abord la flotte à aller s'abriter
derrière le cap
Matifou durant plus de quarante-huit heures.
Puis, le 22 octobre, le temps s'améliorant, les navires reprennent
leur mouillage dans la rade et les préparatifs du débarquement
des troupes sont effectués. Le 23, l'armée débarque
sans difficulté sur les plages bordant les collines de Mustapha,
à l'est d'Alger (17). En même temps, l'escadre s'est déployée
devant la ville qu'elle bloque et les canons de ses galères la
noient sous un déluge de fer et de feu. Le lendemain, après
avoir décimé au canon une grande partie des troupes du dey
Hassan, Charles-Quint installe son quartier général sur
une colline à 800 mètres au sud de la Casbah
(18).
Le succès semble à portée de main, et on se prépare
à l'assaut des dernières défenses barbaresques.
Mais c'est compter sans la traîtrise des éléments
naturels.
Le 24 au soir, le temps devient subitement orageux. Dans la nuit, la tempête
se lève, soudaine et dévastatrice, d'une violence inouïe.
Des torrents de pluie noient le camp impérial, les poudres, les
vivres, tandis que la foudre s'abat partout. A la clarté des éclairs
immenses et ininterrompus, on peut voir beaucoup d'hommes s'enfuir, effrayés,
vers les hauteurs. Sur mer, les vaisseaux arrachés à leurs
ancres par la furie des flots, partent à la dérive, s'abordent
en s'éperonnant et coulent dans une indescriptible confusion. A
l'aube du 25, c'est l'horreur. La mer hideuse, verdâtre et bavante,
est couverte de navires brisés, de pièces de bois flottantes,
de mâtures démantibulées, de cadavres d'hommes broyés,
de corps de chevaux déchirés : 15 galères et 86 vaisseaux
ont déjà péri !
A terre, le coup œil n'est pas moins sinistre. Débarqués
sans tentes ni abris quelconques, sauf les pavillons de l'Empereur dressés
au sommet de la colline, les hommes ont passé toute la nuit debout,
les vêtements trempés, sous une pluie diluvienne et glacée
qui tombe sans arrêt depuis la veille à 9 heures du soir.
Elle durera cinquante heures sans interruption! Les arquebuses, le bassinet
noyé, les couleuvrines, sont inutilisables...
A l'aube, profitant de la tempête, une forte colonne barbaresque
sort de la ville et tombe à l'improviste sur les bivouacs impériaux
établis à flanc de colline, massacre un grand nombre de
soldats, jetant le désordre et la terreur dans le camp. Les Impériaux,
épuisés, luttent au corps à corps, a l'arme blanche,
tantôt pataugeant dans les torrents d'eau qui dévalent des
coteaux, tantôt les pieds englués dans la boue épaisse,
sous les rafales de pluie que le vent nord-est jette au visage des combattants,
en même temps qu'il pousse les vaisseaux à la côte.
Cependant, supérieurs en nombre, les Impériaux se resaisissent
et repoussent les assaillants qu'ils poursuivent jusqu'aux remparts de
la ville, devant la porte d'Azoun. En tête, les chevaliers de Malte
qui y parviennent pêle- mêle en combattant avec l'arrière-garde
barbaresque. Les Turcs se sont engouffrés dans la porte qu'ils
referment précipitamment ensuite, laissant un grand nombre des
leurs à l'extérieur des remparts. Ces Barbaresques s'enfuient
par les fossés ou sont massacrés par les Impériaux.
Mais les défenseurs d'Alger qui ont garni les remparts font une
décharge générale d'artillerie, de traits d'arbalète
et de pierres sur les chrétiens qui, saisis de panique, se débandent
et s'enfuient. Seuls, les chevaliers de Malte (19) se retirent dignement,
en bon ordre.
Les Turcs ressortent et se lancent à la poursuite des fuyards,
enveloppent les chevaliers de Malte qui sont près de succomber
sous le nombre. A cet instant, survient l'Empereur lui-même, avec
sa Maison et ses lansquenets allemands, qui contraint l'ennemi à
la retraite et le reconduit jusqu'à la porte d'Azoun. Charles-
Quint maintient ses troupes quelque temps sous le feu de la place et les
ramène ensuite vers leurs positions.
La pluie tombe toujours, inlassablement...
Les hommes sont épuisés, profondément démoralisés.
La situation de l'armée est préoccupante certes, mais non
désespérée cependant.
Celle de la flotte, en revanche, se présente beaucoup plus grave.
La flotte - ou ce qu'il en reste - qui détient encore dans ses
flancs l'essentiel de ce qui est nécessaire à l'armée
pour qu'elle poursuive son action à terre ! Or 140 bâtiments
de transport ont péri déjà, coulés corps et
biens, échoués ou brisés sur les plages où
des nuées de Barbaresques pillent les épaves et massacrent
sans pitié les naufragés. Les navires jusque-là épargnés
par la tempête sont terriblement malmenés. Pour les soustraire
au danger, Doria les conduit vers l'avancée orientale du cap Matifou
qui les abritera quelque peu. Puis l'amiral fait prévenir l'Empereur
qu'il lui reste juste assez de vaisseaux pour suffire au rembarquement
de l'armée. Opération qui, vu l'état dela mer, ne
pourra s'effectuer qu'au cap Matifou (20).
La tempête ne désemparant toujours pas et l'état de
l'armée devenant inquiétant, Charles-Quint comprend alors,
la mort dans l'âme, que le salut de la flotte et celui des troupes
exigent une prompte retraite. Il doit abandonner son projet, quoi qu'il
lui en coûte...
Le jour même, il rassemble ses troupes, et, laissant derrière
lui matériel, artillerie, bagages et vivres même, les met
en marche vers le cap Matifou, à peine distant d'une trentaine
de kilomètres. Distance peu importante, mais il faudra cependant
plus de quarante-huit heures pour la couvrir, au prix de fatigues inouïes...
Le terrain détrempé, couvert d'obstacles naturels, de marais
fangeux (21), rend la marche lente et pénible. Fantassins et cavaliers,
anéantis de fatigue se traînent dans la boue, sous la pluie
incessante, démoralisés par le froid. Les flancs de la colonne
sont défendus par les divisions italiennes et allemandes et elle
s'achemine sous la protection des cavaliers espagnols et des derniers
chevaliers de Malte. L'Empereur chevauche avec l'arrière-garde
qui, seule encore, présente un aspect guerrier et grâce à
qui les Barbaresques restent à distance. De loin, les musulmans
suivent le spectacle de cette formidable armée chrétienne
qui regagne avec peine sa flotte décimée. La colonne se
traîne ainsi deux jours durant, repoussant les attaques incessantes
des Barbaresques qui la harcèlent, égorgeant les traînards
et massacrant les blessés que les soldats, rendus impitoyables
par leurs propres souffrances, abandonnent derrière eux, afin de
n'être pas retardés dans leur marche. En cours de route,
on abat des chevaux pour se nourrir.
Successivement, deux obstacles sérieux barrent la route des fuyards
: l'Harrach et le Hamiz, en crue tous deux et débordant largement
de leurs lits. Il faut aller chercher sur les plages (22) des carènes
de navires échoués, les mettre bout à bout pour en
confectionner des pont. L'ouragan, heureusement, diminue d'intensité...
Le cap Matifou enfin atteint, l'armée reçoit des vivres
de la flotte et peut prendre quelque repos. Le lendemain débute
l'embarquement, vite interrompu par un nouveau grain violent. Les navires
qui ont reçu leur chargement prennent aussitôt le large.
Après deux jours d'interruption, les opérations d'embarquement
reprennent. L'Empereur monte à bord du dernier. Ultime crève-cceur
pour le monarque, il a fallu jeter à la mer les plus belles pièces
d'artillerie amenées jusqu'ici au prix des plus grandes souffrances
(23) et abattre presque tous les chevaux (24). Le choix s'était
posé, inéluctable : hommes, canons ou chevaux... Le mauvais
état de la mer contraignit Charles-Quint à séjourner
par deux fois à Bougie, quatorze jours d'abord et six jours ensuite.
Il atteignit Palma de Majorque le 23 novembre. Il en était parti
triomphalement cinq semaines auparavant ; il y revenait vaincu, ayant
subi un immense désastre.
Quelques mois plus tard, la Turquie et la France concluaient une nouvelle
alliance, défensive et offensive...
Le spectre de la défaite
Ce désastre de l'expédition
espagnole de 1541 constituait un fréquent sujet de méditation
pour l'état-major français. Et ce jour-là, au milieu
de la formidable tourmente, ce souvenir inquiétant occupait seul
les esprits. On tremblait sous la menace d'une catastrophe semblable.
Comme les Espagnols près de trois siècles auparavant, les
Français voyaient se profiler devant eux le spectre de la défaite.
La mémoire du passé ajoutait aux craintes du présent!
Instruit des erreurs tactiques commises par Charles-Quint, de Bourmont
s'était efforcé d'en éviter la réédition
: le débarqement s'était effectué à distance
de la ville- objectif, on n'avait pas avancé, ni attaqué,
sans prendre la précaution d'établir un camp retranché
et approvisionné, assurant la position ainsi que les arrières
de l'armée sur le terrain. En 1541, les conditions atmosphériques
exceptionnellement défavorables avaient été suffisantes
pour déterminer la perte de l'expédition espagnole placée
en porte à faux sur le littoral algérois. Celles auxquelles
était aujourd'hui confrontée l'armée française
se présentaient tout aussi défavorablement, mais, grâce
aux précautions prises jusque-là, sa situation se révélait
cependant moins critique : dans l'hypothèse même d'une destruction
de la flotte, partielle ou totale, l'armée pouvait tenir, ramassée
sur la position de repli, jusqu'à l'arrivée des secours
que Toulon ne manquerait pas d'envoyer au plus vite.
De Bourmont conservait tout son sang- froid, mais les craintes suscitées
par l'ouragan qui ne faiblissait toujours pas l'incitèrent à
prendre certaines mesures de prudence. C'est ainsi que, durant quelques
instants, il songea à abandonner la ligne jusque-là tenue
par les deux premières division en avant de Sidi-Ferruch pour venir
s'établir sur une autre ligne, plus rapprochée du point
de débarquement et plus facile à défendre, dans l'hypothèse
d'un revers de ses troupes. En conséquence, ordre fut même
envoyé au maréchal de camp Clouet de rétrograder
sa brigade placée à l'extrême gauche du théâtre.
Mais le généralissime revint sur sa décision hâtive
lorsque, ayant reçu les lieutenants-généraux Berthezène
et Loverdo, respectivement commandants des ire et 2e divisions, ceux-ci
le rassurèrent sur l'état des munitions et le moral de la
troupe, satisfaisants selon eux. Puis les deux officiers généraux
s'attachèrent à démontrer à leur supérieur
l'inconvénient sérieux d'une rétrogradation générale
des lignes qui se révélerait nuisible pour le moral des
troupiers dont la confiance serait diminuée, Tandis que celle de
l'adversaire en serait ranimée. Berthezène déclara
que, quant à lui, il répondait de sa position actuelle,
dût-il la défendre à la baïonnette et Loverdo
abonda dans ce sens. Alors soulagé, de Bourmont abandonna toute
velléité de repli, à la satisfaction de ses deux
subordonnés.
Mais ce problème réglé, demeurait celui aigu, des
approvisionnements dont la flotte détenait encore la majeure partie.
Or de son côté, le vice-amiral Duperré, bien que lui-même
confronté à cet instant avec le périlleux problème
de la conservation de ses bâtiments, livrés tels des jouets
à la fureur de la tempête, n'oubliait-il pas la question
majeure des approvisionnements de l'armée de terre. Aussi, l'ouragan
ne perdant rien de sa vigueur, eut-il l'idée de faire jeter tous
les vivres par-dessus bord. Initiative rendue possible grâce à
la précaution qu'avait eue, avant le départ de Toulon, l'intendant
général Denniée de munir tous les approvisionnements
de doubles enveloppes imperméables (25). Et l'on vit bientôt
jaillir de tous les navires alertés par signaux, ballots, caisses
et barils qui, touchant à peine l'eau, étaient aussitôt
emportés avec force par les lames et poussés par le vent
violent vers la plage où ils s'échouaient promptement. "
Lancés à la mer avec une incroyable célérité,
nous dit l'intendant en chef, les caisses de biscuits, les tonneaux de
vin ou d'eau de vie, de farine, de légumes, les ballots de foin,
les sacs d'orge et d'avoine, vomis avec la vague, venaient échouer
sur le rivage. "
Ainsi la tempête elle-même allait-elle aider au débarquement
des denrées que les navires ne pouvaient assurer. La prévoyance
humaine utilisait l'obstacle comme un moyen de parvenir tout de même
à ses fins.
En quelques minutes, l'immense plage de sable blond s'était couverte
de caisses et d'objets divers qui s'entassaient pêle- mêle
sur une grande étendue et dans une incroyable confusion, offrant
sur une grande étendue un aspect lamentable. Le ramassage, le classement
et la mise en sûreté de cette masse de colis exigera trois
jours pleins d'un travail de fourmi à de très nombreuses
corvées.
La fin d'un cauchemar
A peine la mise à l'eau de tous ces
objets était-elle terminée, vers midi, que le vent changea
brusquement de direction. Alors qu'il avait longtemps et violemment soufflé
du nord-ouest, sans transition aucune, il sauta subitement à l'est.
En quelques minutes, sa force s'amortit considérablement, sa vitesse
chut tout à fait et, par effet de cause, la houle s'apaisa rapidement,
elle aussi.
Et bientôt le soleil refit son apparition.
Dans le ciel qui commençait à se dégager par larges
pans d'un bleu pur, on le vit reparaître d'abord timidement, jaune
pâle, comme étrangement dépouillé de ses rayons.
Mais cela ne dura pas longtemps. Un quart d'heure après, il avait
retrouvé tout son éclat et sa chaleur. Un témoin
oculaire (26) nous résume succinctement tout ce qui vient d'être
exposé : " Sidi Ferruch, le 16 juin 1830... Levé ce
matin à 3 heures pour continuer les opérations du débarquement
du matériel, j'étais un peu appesanti par la chaleur...
Les nuages se sont amoncelés, un vent terrible est arrivé
du nord-ouest, le tonnerre a grondé au milieu des éclairs,
des torrents de pluie ont arrosé la plage et nous avons eu les
inquiétudes les plus grandes pour le sort de la flotte. Le vent
portait les bâtiments à la côte ; déjà
plusieurs avaient tiré le canon d'alarme et nos bateaux à
vapeur s'efforçaient de remorquer ceux qui étaient en danger.
Cela a duré pendant plus de trois heures. Les faibles se souvenaient
de l'expédition de Charles-Quint et de l'orage qui détruisit
son armée. Des regards sinistres s'échangeaient, de sinistres
paroles se prononçaient, quand tout à coup le vent s'est
moqué de nous et de nos alarmes et, passant du nord-ouest au sud-est,
a repoussé les flots qui se jetaient furieux au rivage, chassé
les nuages épais et séché nos toilettes endommagées..."
Partout, à terre comme à la mer, on retrouvait la joie de
vivre, après avoir désespéré plusieurs heures
durant. Les troupiers s'efforçaient de rétablir leurs installations
inondées et se hâtaient de remettre leurs armes en état.
Déjà, la masse d'eau déversée par la pluie
torrentielle avec une violence telle que le sable même n'avait pu
l'absorber, commençait à s'évaporer sous les chauds
rayons du soleil. Mais les tranchées, les trous individuels demeuraient
encore emplis d'eau boueuse et les petits ouvrages défensifs bâtis
de terre, de pierrailles et de branchages amalgamés, étaient
écroulés. Ce n'était pas trop grave, les Barbaresques
avaient sans doute eux aussi subi les mêmes désagréments
et, de fait, ils ne reparurent pas de tout l'après-midi. Jusqu'au
soir, la terre fuma littéralement, sur le territoire occupé
par les Français et partout là-haut sur les collines, en
direction du plateau de Staouéli. Les deux adversaires allumaient
ensemble les mêmes feux de bois vert et mouillé pour sécher
leurs vêtements trempés et leurs armes inondées!
De leur côté, les marins procédaient à l'examen
des dégâts infligés par la tempête. Ils se révélèrent
finalement moins importants qu'on ne l'avait craint. Quelques vaisseaux
avaient eu leur gouvernail brisé, des ancres étaient perdues,
des gréements endommagés, mais tout cela était réparable.
Dans l'ensemble, les navires, mieux et plus solidement construits que
ceux du 16e siècle, avaient bien soutenu le choc de l'ouragan.
Il n'en allait pas de même pour les navires de commerce et pour
les petits bâtiments qui avaient subi des pertes sérieuses.
L'optimisme revenait en force chez les marins. Car l'alerte avait été
sérieuse. Comme l'écrivit le vice-amiral Duperré
(27) : "Si ce temps s'était prolongé deux heures de
plus, la flotte était menacée d'une destruction peut-être
totale. Le vent a sauté du nord-ouest à l'Est, et aussitôt
la mer est tombée... Mais la leçon a été effrayante
pour tout le monde, à terre comme à la mer... " Et
le chef de la flotte révisait déjà à la baisse
l'opinion qu'il avait émise, le 13, quant à la sûreté
de la baie (28).
A l'opposé de l'affreuse matinée, l'après-midi se
révéla radieux.
L'ouragan avait sensiblement rafraîchi l'atmosphère et la
légère brise d'est qui soufflait maintenant chassait les
vapeurs qui l'alourdissaient. La pureté de l'air était telle
que les Français semblaient découvrir pour la première
fois le paysage magnifique qui s'offrait à leurs yeux : d'immenses
plages de sable blond se déroulaient sans fin de part et d'autre
de la presqu'île, baignées par une mer étincelante
dont le cobalt vif allait se confondre à l'horizon avec le ciel
pur. Jusqu'au lointain, ces plages claires enserraient les terres ocres
et vertes qui montaient à l'assaut des hautes collines du Sahel
et bornaient la vue au nord et à l'est, puis s'abaissaient graduellement
vers le sud et la Mitidja avec, en toile de fond grandiose, les sommets
violacés de l'Atlas blidéen dont l'ultime chaînon,
le mont Chenoua,
allait s'abîmer brusquement dans la mer.
Quelque chose au loin intriguait beaucoup ces spectateurs attentifs. C'était,
vers le sud-ouest, juché sur un grand mamelon dénudé,
dernier ressaut des hauteurs littorales, un étrange monument que
le soleil de l'après-midi colorait d'une belle platine dorée.
Seuls quelques officiers de l'expédition et les savants qui l'accompagnaient
savaient qu'il s'agissait du mausolée d'un prince berbère
romanisé (29), énorme masse de pierres blanches, haute comme
une colline, que près de dix lieues de pays rapetissaient à
la dimension d'une ruche.
Lorsque le soleil se coucha à l'horizon, ce soir-là, le
coup œil devint admirable et même les natures les plus frustes,
les plus brutes parmi ces milliers d'hommes réunis là, ne
purent rester insensibles à la magnificence de ce spectacle féerique,
d'une extraordinaire beauté. La munificence de ce paysage qui,
jusque-là, leur avait semblé fermé, hostile et inquiétant,
inclinait les troupiers à l'euphorie, réaction inconsciente
aux frayeurs de la matinée. Cette joie éclata partout, en
même temps que s'allumaient les feux de bivouacs, lorsqu'une abondante
répartition de vin ainsi que de pain frais, tout chaud sorti des
fours de campagne, la première depuis le débarquement, fut
effectuée parmi les compagnies. Et cette liesse se propagea jusque
sur l'eau, ce soir-là, parmi les marins de la flotte, eux aussi
galvanisés par une ample distribution de rhum.
La nuit tout à fait tombée, on s'organisa du mieux possible
afin de passer une nuit réparatrice, tandis que gardes et grand
gardes se mettaient en place pour veiller à la sécurité
du camp et des lignes.
Et chacun s'endormit bientôt, roulé dans sa couverture ou
son manteau, envisageant avec sérénité et confiance
la journée prochaine.
Gaston PALISSER.
Prochain article :
"La veillée d'armes". (note
du site: hélas, je n'ai pas ce n°. Pas de veillée!.Quelle
cruauté!)
(1) Voir L'Algérianiste n° 31, septembre 1985, p. 14 et no
37, mars 1987, p. 4.
(2) Voir L'Algérianiste n° 39 de septembre 1987, p. 8 sqq.
(3) Voir supra, note 2.
(4) J.-T. Merle : Anecdotes pour servir à l'histoire de la conquête
d'Alger en 1830.
(5) Jean-Ernest Ducos de La Hitte, maréchal de camp, commandant
l'artillerie du corps expéditionnaire, à l'époque,
le plus jeune général de l'armée française.
" Ce général semblait se multiplier pour être
partout à la fois, nous dit A. Nettement (Histoire de la conquête
d'Alger, p. 367), impatient de montrer la supériorité du
nouveau matériel sur l'ancien, il parvenait avec ses pièces
aux avant-postes en traversant les terrains les plus difficiles...,, On
le voyait partout à la fois, ajoute l'ingénieur-géographe
Rozet (Relation de la guerre d'Afrique, 1830), il accompagne de Bourmont
dans la visite des lignes, puis revient au milieu des batteries pour faire
tout disposer, ensuite il court activer le débarquement de son
matériel et veille au placement des objets dans les parcs... "
Indéniablement, la contribution de cet officier général
au succès de la campagne fut importante.
(6) Bâtiments de guerre délestés d'une partie de leur
artillerie et provisoirement affectés au transport des troupes
et du matériel.
(7) La toute nouvelle marine de guerre à vapeur conquit ses lettres
de noblesse au cours de cette formidable tempête. Six unités
composaient cette division, pour la première fois employées
au cours d'opérations militaires. La marine traditionnelle accueillait
avec dédain cette nouveauté (voir Cap sur Alger, de BernardiniSoleillet,
Editions de l'Atlanthrope, p. 95) que les marins de ,,la vraie marine
", celle des fins voiliers, appelaient !d'escadre des chaudrons flottants
" ou encore, nn mouches d'escadre ", sobriquet dû à
l'activité incessante déployée par ces vapeurs lors
de la longue traversée. Très souvent, on avait pu les voir,
allant et venant sans arrêt de la tête à l'arrière-garde
du convoi, tels des chiens de berger, crachant d'épais panaches
de fumée noire et faisant force vapeur pour transmettre les ordres
de l'amiral ou porter assistance à un bâtiment en difficulté.
A la longue pourtant, il fallut bien reconnaître que les n< machines
à feu,, à l'allure pataude, propulsées par leurs
encombrantes roues à aubes, s'étaient affranchies des servitudes
du vent. Au début de cette même année 1830, le ministère
français de la Marine avait vainement tenté d'augmenter
le nombre de ces navires à vapeur par des affrètements en
Angleterre, laquelle possédait déjà, cette époque,
une flotte de plus de 300 bâtiments de ce type.
(8) La pointe Saint-Janvier.
(9) Le Grand Rocher et le Rocher du Milieu.
(10) Bâtiments de guerre chargés de toute leur artillerie.
(11) Claude-Charles-Marie de Campe de Rosamel, contre-amiral, commandant
en second de l'armée navale, cinquante ans à l'époque,
homme d'un port magnifique et d'une belle figure, très audacieux
et très expérimenté. Il fut nommé vice-amiral
et préfet maritime de Toulon. Ministre de la Marine de 1836 à
1839 et mourut en 1848.
(12) Louis-Auguste-Victor de Ghaisne de Bourmont, lieutenant-général,
ministre de la Guerre en 1830 et commandant en chef de l'expédition.
C'était alors un homme de cinquante-sept ans, de petite taille,
grand nez et traits nobles, un air fin et rusé. Emigré de
1791, il revint en Vendée combattre les Chouans. Rallié
à l'Empire, fut nommé colonel puis maréchal de camp.
Rejoignit Louis XVIII en 1814. S'exila après la Révolution
de juillet 1830, revint en France et y mourut en 1846.
(13) Baron de Tholozé, maréchal de camp et sous-chef d'état-major.
Ancien officier de l'Empire.
(14) J.-T. Merle. Voir supra, note 4.
(15) Lieutenant-général Desprez, chef d'état-major.
Général de division sous l'Empire, réintègre
l'armée pendant la Restauration. Homme de petite taille, sec et
pointu, mais possédant de réels talents militaires.
(16) En réalité, les Frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem
ou chevaliers-moines, qui guerroyaient partout en Méditerranée
contre l'Islam. Successivement chassés, par les Turcs de Jérusalem
(1187), de Saint-Jean-d'Acre, de Chypre (1291), puis de Rhodes (1308),
ils s'étaient installés à Malte en 1530. En 1541
encore ils s'intitulaient ,,chevaliers de Rhodes " et se considéraient
comme en exil à Malte, n'ayant pas renoncé à retourner
à Rhodes. Un grand-maître ou prince ayant le pape pour seul
suzerain commandait l'ordre qui dura jusqu'à la prise de Malte
par Bonaparte, en 1798.
(17) Les plages des Sablettes et d'Hussein-Dey, à partir de la
pointe Tafourah. Souvenons-nous, dans cette banlieue d'Alger, du hameau
Charles-Quint.
(18) Le Koudiat eç Çaboun, la colline du Savon sur laquelle
Hassan Pacha fit d'abord édifier une tour ronde armée de
trois canons. Puis, en 1579. craignant un retour des Espagnols, la fit
fortifier, l'encadrant de quatre bastions. En 1656, la foudre endommagea
cette construction qui subit des modifications importantes (H. Klein,
les Feuillets d'El Djezaïr, T. 3, 1912). Un temps, la forteresse
porta le nom de Bordj el Taous (fort des Paons), un dey y ayant fait élever
des paons, puis celui de Soltan Kalassi (Fort-l'Empereur).
(19) Deux plaques de marbre étaient apposées, l'une rue
des Chevaliers-de-Malte, l'autre à l'angle des rues Littré
et Bab-Azoun, à Alger. La première nous rappelait l'héroïsme
de ces chevaliers et le texte de la seconde commémorait le geste
de Ponce de Balaguer, dit Savignac, porte-étendard de cet ordre
qui, sous une grêle de traits, aurait planté sa dague dans
la porte d'Azoun, en disant ,,Nous reviendrons ! ", prophétie
qui. ajoute l'inscription, se réalisa le 5 juillet 1830 avec l'arrivée
des troupes françaises...
C'est interpréter l'événement avec autant de fantaisie
que Victor Hugo écrivant, à propos de l'expédition
de 1541 (le Rhin, 1838), que : u Villegaignon avait failli donner Alger
à la France dès les 16e siècle... " car, comme
tous les mots historiques, celui attribué à Savignac n'a
vraisemblablement jamais été prononcé. Comme l'indique
excellemment M.-E. Ravenet dans son opuscule : Un épisode de l'expédition
de 1541 (Société historique algérienne), la légende
trouve origine dans un passage de la Relation de A. Magnolotti, écrivant
notamment que : "... le bruit court que le frère Pontion di
Bilinguer, dit de Savignac, Français, planta son poignard dans
la porte..... Or cet auteur n'avait pas assisté à l'échauffourée
et, de plus, sa relation comporte des inexactitudes et des invraisemblances
telles que son authenticité peut être à bon droit
mise en doute. En outre les gestes et les mots attribués à
de Savignac ne sont rapportés dans aucun récit contemporain,
dont notamment la relation du chevalier de Villegaignon qui avait pourtant
participé à l'attaque de la porte d'Azoun et y avait même
été grièvement blessé.
Puis, au cours des siècles suivants, divers auteurs reprirent les
propos de Magnolotti sans jamais mentionner qu'il s'agissait là
d'un bruit et non d'un fait authentique. Et en 1843, Berbrugger, dans
Algérie historique pittoresque et monumentale, remit en mémoire
l'épisode en question, sur l'authenticité duquel il n'élevait
d'ailleurs aucun doute. Reprochant à ses compatriotes leur ingratitude,
il ajoutait : "... nous n'avons pas eu l'idée de consacrer
par un monument, une simple inscription, un nom donné à
une rue, le souvenir de ce héros qui, au nom de la France, vint
frapper audacieusement à la porte d'Alger... " L'ouvrage s'ornait
d'un tableau de Raffet intitulé : " Pons de Balaguer à
la porte de Bab-Azoun " [sic] et représentant le chevalier
plantant sa dague dans la porte, gravure devenue classique. Trois ans
plus tard, H. de Grammont, dans le commentaire dont il faisait suivre
sa traduction de la relation latine de Villegaignon, reprenait le thème
de Berbrugger. Comme ce dernier, il exaltait le prétendu fait d'armes
de Savignac et même, donnant libre cours à son imagination,
l'enrichissait de détails nouveaux.
Ainsi, par la contribution successive d'auteurs peu exigeants et inspirés
de sentiments certes respectables, mais qui n'avaient rien de commun avec
la critique historique, s'est formée une légende née
d'un on-dit, d'un bruit anonyme et incontrôlable, que des préventions
d'ordre sentimental feront accepter comme une réalité. Notons,
de plus, que ce ne pouvait être au nom de la France, alors alliée
des Turcs, mais bien au nom de l'Espagne, alors ennemie mortelle des deux
premières, que les chevaliers sont venus frapper à la porte
d'Azoun, simple constatation qui, à elle seule, contredit formellement
les affirmations de Berburgger et de Grammont (20). L'amiral Doria, apuyé
par le pape Paul III, avait vainement supplié l'empereur de ne
pas entreprendre l'expédition dans cette période de l'année.
Il lui avait demandé d'attendre une saison plus propice à
la navigation. Doria, marin très expérimenté, disait
: "Il n'y a que deux ports en Afrique : juin et juillet, en dehors
de ces deux périodes, les risques sont grands ! "
(21) Notamment entre Fort-de-l'Eau et le Hamiz.
(22) C'est-à-dire les plages
d'Hussein-Dey, du Polygone d'artillerie et de Fort-de-l'Eau.
(23) Selon quelques auteurs contemporains, en 1830 encore, on pouvait
apercevoir, au cap Matifou, par mer calme, d'énormes fûts
fortement oxydés, à demi ensablés et envasés,
gisant par quatre ou cinq mètres de fond.
(24) Selon Brantôme, la perte de ces chevaux, " magnifiques
genêts d'Espagne ", sera ressentie plus tard comme " le
grand deuil du désastre", par Charles-Quint.
(25) L'amiral de Rigny avait prédit à l'intendant Deniée
les coups de vent et les accidents fréquents sur les côtes
de la Régence. C'est en prévision de cette fâcheuse
éventualité que le responsable de l'intendance avait eu
l'heureuse idée de munir tous les colis de doubles enveloppes imperméables.
(26) Paul Raynal, sous-intendant : l'Expédition d'Alger, 1830,
Lettres d'un témoin.
(27) Rapport du 17 juin 1830 au ministre de la Marine.
(28) Arrivant en baie de
Sidi-Ferruch, le 13 juin, et constatant l'excellence de ce
mouillage, le vice-amiral avait dit textuellement au chef d'état-major
de l'armée de terre, le général Desprez : "
la flotte sera aussi en sûreté dans cette baie que dans la
rade de Toulon..... (Journal d'un officier de l'Armée d'Afrique,
pp. 73 et 74).
(29) Le K'bour roumia ou Tombeau
de la Chrétienne, monument composite colossal, vraisemblablement
construit aux environs de l'an 20 de notre ère, et, très
probablement, tombeau de Juba II, roi de Numidie ainsi que de son épouse,
Cléopatre Séléné, fille de la grande Cléopâtre.