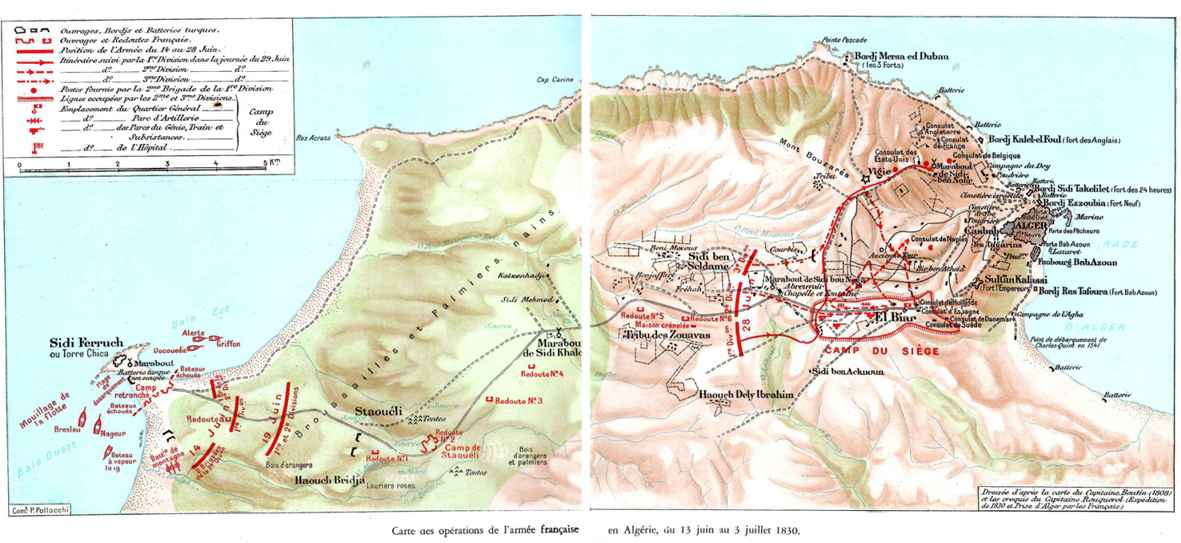L'armée expéditionnaire française
destinée à conquérir Alger était arrivée
le 13 juin devant la côte d'Afrique, et, le même soir, l'immense
flotte, comptant plus de 100 bâtiments de guerre et environ 400
navires de commerce, jetait l'ancre dans la baie de Sidi Ferruch.
Le 14, à l'aube, les premières troupes prenaient possession
du sol algérien. C'était la brigade du maréchal de
camp Poret de Morvan, de la division Berthezène. Rapidement, Sidi
Ferruch fut occupé, pendant que les canons des vaisseaux réduisaient
au silence les batteries turques. Dans la journée, toute l'armée
mise à terre se fortifia dans la presqu'île, où le
général de Valazé, commandant le génie, traça
des retranchements qui mirent le camp à l'abri d'un coup de main.
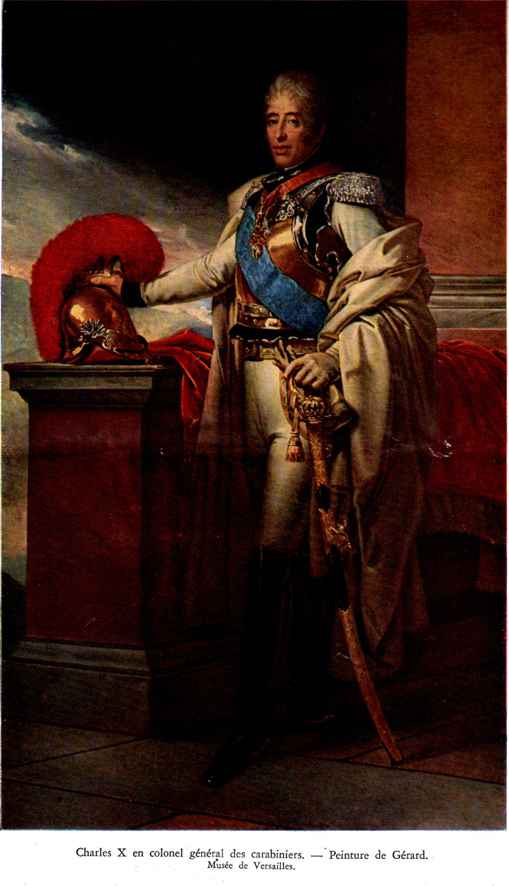 Charles X en colonel général des carabiniers |
Les Arabes et les Turcs se contentèrent, pendant
les premiers jours, de tirailler derrière les buissons et d'opposer
une résistance d'arrière-garde à l'avance des Français,
non sans leur infliger cependant des pertes. C'était, pour le moment,
la tactique du dey, dont le gendre, l'agha Ibrahim, commandait les troupes.
Laisser les Français débarquer, puis les rejeter à
la mer, comme cela avait été fait
, puis les rejeter à la mer, comme cela avait été
fait pour Charles-Quint et O'Reilly, telle était la seule manœuvre
qu'ils concevaient.
L'agha établit son camp principal à Staouéli et appela
à lui tous les contingents des grands vassaux et amis. Le sultan
du Maroc et le pacha de Tripoli n'avaient répondu aux demandes
du dey que par de vagues promesses et des vaux platoniques ; mais les
beys de Constantine, d'Oran et de Titteri envoyèrent chacun 13.000
à 15.000 hommes. Avec les janissaires et les milices de la Régence,
cela faisait une armée de 6o.000 hommes, exactement le double de
l'armée française.
La vie à Alger pendant toute la campagne nous est connue au jour
le jour par le récit très curieux d'un Allemand, Simon Pfeiffer,
ancien étudiant en médecine, pris par un corsaire dans la
Méditerranée et devenu esclave du ministre des. Finances.
En ville tout était désordre et présomption. L'aspect
de la flotte française défilant au large émut d'abord
les populations ; mais, lorsqu'on annonça que le dey augmentait
la prime qu'il promettait de payer pour chaque tête de Français,
une nouvelle ardeur guerrière s'empara des hommes.
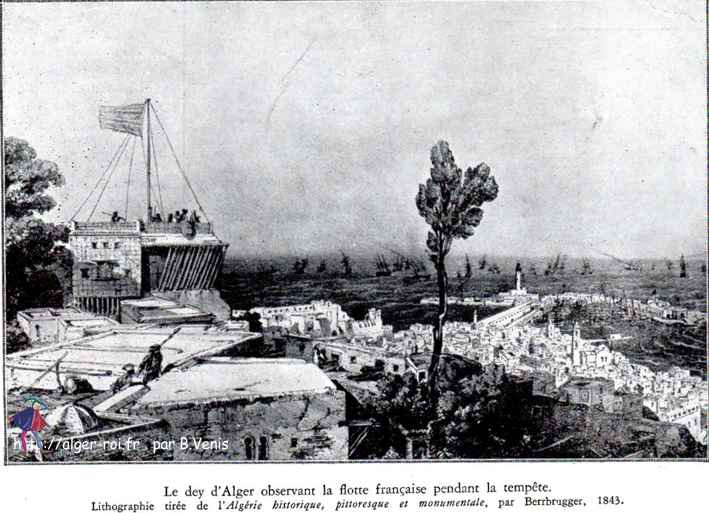 Le dey d'Alger observant la flotte française |
A Sidi Ferruch, au delà des retranchements, nos
grand-garde tiraillaient nuit et jour, tandis que sur la plage une activité
fébrile et ordonnée régnait. On débarquait
vivres, munitions, les mille choses dont une armée a besoin ; les
ambulances,. les dépôts d'intendance élevaient leurs
baraquements et, plus loin, selon mode des temps napoléoniens,
les cantinières, aidées par les soldais, dressaient des
tonnelles de verdure où l'on buvait frais.
Le 16, une épouvantable tempête faillit provoquer la perte
de la flotte. Mais, alors que tout le monde craignait de voir se répéter
la catastrophe de Charles-Quint, une brusque saute de vent chassa l'orage
et sauva l'armée.
Impatiemment, elle attendait le moment de marcher. Une erreur de jugement
de l'amiral Duperré en retarda l'exécution. Malgré
de nombreux avis, il craignait que la baie de Sidi Ferruch ne fût
pas assez grande pour opérer à la fois tous les débarquements
et avait fait retarder la marche de deux sections du convoi qui transportaient
la majorité des chevaux.
Devant cette immobilité des Français, l'agha
Ibrahim, généralissime des armées du dey, résolut
de prendre l'offensive. Son plan de bataille consistait à faire
harceler notre aile droite par le bey de Constantine et à crever
la gauche avec l'élite de ses troupes, la milice et les contingents
de Titteri.
L'action s'engagea le 18 avant l'aube. De notre côté, sentant
l'attaque prochaine, on avait retiré les troupes sur de meilleures
positions et porté l'artillerie en première ligne. L'assaut
des Algériens fut d'une violence inouïe et la situation fort
critique à notre aile gauche. La brigade Clouet, d'abord repoussée,
avait contre-attaqué avec une telle fougue qu'elle se trouva bientôt
en l'air et sans cartouches. La présence d'esprit du lieutenant-général
duc des Cars sauva la situation. Il commandait la réserve et, sans
attendre l'ordre du général de Bourmont, amena les renforts
qui dégagèrent notre gauche.
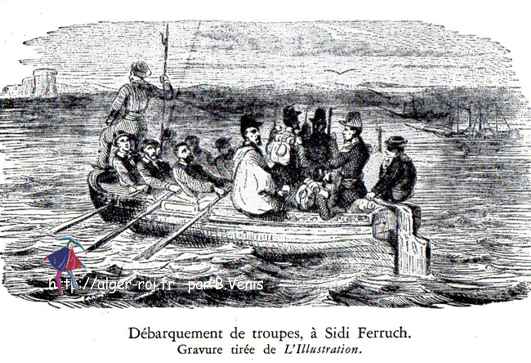 Débarquement de troupes, à Sidi Ferruch. Gravure tirée de L'Illustration. |
L'aile droite, moins vigoureusement attaquée, avait
aisément maintenu ses positions. L'assaut ennemi ainsi brisé,
nos troupes partirent à la contre-attaque, rejetant l'armée
du dey jusque devant son camp principal qui se trouvait à Staouéli.
Puis, sans désemparer, décidé à exploiter
le succès, le général de Bourmont lança ses
divisions sur le camp. Le mauvais terrain, qui retarda la marche de la
division Loverdo, sauva seul l'armée ennemie d'un désastre
complet. Son artillerie, ses drapeaux, ses munitions, les vivres, les
tentes, d'immenses troupeaux de moutons et de boeufs, les chevaux, les
chameaux, tout tomba entre les mains des Français. Fait d'armes
encore plus important que la prise de la smala, la bataille de Staouéli
nous ouvrait la route d'Alger.
Malheureusement, le retard du convoi naval privait l'armée de chevaux
et empêchait d'avancer, bien que déjà, en pleine bataille,
le génie eût construit la route qui, du camp de Sidi Ferruch,
menait jusqu'au front. La panique des troupes algériennes avait
été si complète qu'elles étaient venues se
réfugier dans les murs de la ville et que l'agha Ibrahim, craignant
le courroux du dey, se tenait caché dans une maison de campagne.
A défaut de son gendre, le dey confia alors le commandement de
l'armée au bey de Titteri, homme énergique et courageux,
sous l'impulsion duquel Turcs et Arabes se reprirent à harceler
notre front.
A la suite d'une nouvelle marche en avant, nous occupions alors le plateau
de Sidi Khalef. Situation à la vérité médiocre,
mais qui nous permettait, une fois à pied d'•euvre, de nous
élancer d'un seul trait jusqu'à la Bouzaréa et devant
les murs d'Alger. Des combats meurtriers se livrèrent sur ce plateau
; la chaleur était étouffante et les troupes souffraient
cruellement. Plus de 2.000 hommes furent évacués. C'est
là que le lieutenant Amédée de Bourmont, deuxième
fils du commandant en chef, fut mortellement blessé.
Entretemps, les bâtiments du convoi étaient arrivés
à Sidi Ferruch et les chevaux débarqués.
Bourmont, enfin en possession de tous ses moyens, fixa la reprise de l'offensive
au 29 juin. Son dispositif général portait la gauche (3e
division, duc des Cars) sur les hauteurs de la Bouzaréa, le centre
(2« division, Loverdo) de face devant le château de l'Empereur,
et la ire division (Berthezène) sur la droite, entre le Fort l'Empereur
et la mer.
A 4 heures du matin, l'armée sortit des tranchées et, d'un
seul bond, atteignit les objectifs fixés. Le rôle principal
avait été dévolu à la 3' division qui, marchant
par trois colonnes, bouscula les Turcs et gravit au pas de charge les
pentes escarpées de la Bouzaréa. A 5 heures, le 170 de ligne
(colonel Duprat, de la brigade Hurel) atteignait le point culminant, la
Vigie. De cet observatoire, nos soldats voyaient à leurs pieds
Alger la Blanche, dominée par la masse grise de la kasbah ; plus
loin, le château de l'Empereur et tous les forts et batteries de
la côte, le long de laquelle les maisons de campagne s'étageaient
au milieu des jardins.
Au centre et à droite, la résistance avait été
moindre et, sans pertes importantes, nos soldats occupèrent les
maisons des consuls étrangers, qui, sauf celui d'Angleterre, s'étaient
réfugiés au consulat d'Amérique, situé sur
les pentes nord de la Bouzaréa.
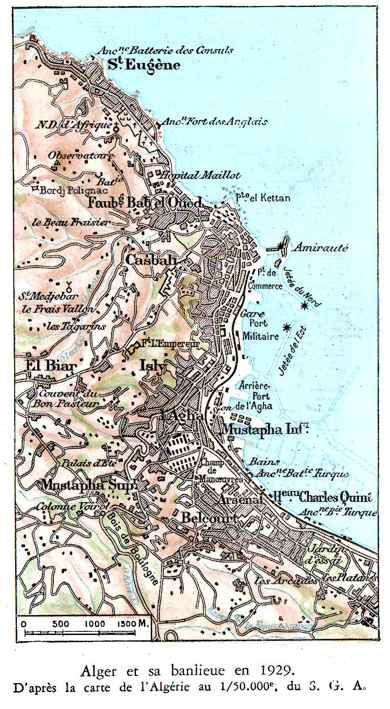 Alger et sa banlieue en 1929 |
Il faisait une chaude journée d'été. L'épais
brouillard matinal qui s'étendait sur le golfe et la Mitidja occasionna
une singulière erreur de la part de l'état-major général.
Son chef, le général Desprez, voyant la nappe grise qui
recouvrait la plaine, crut que c'était la mer et, malgré
les indications précises de la carte de Boutin, commanda aux divisionnaires
de se reporter vers la gauche, commettant ainsi une erreur de 90 degrés.
Ce n'est que lorsqu'il fut revenu à la Vigie, auprès du
duc des Cars, que le général de Bourmont se rendit compte
de la situation. Mais déjà les divisions étaient
en marche à travers le terrain inextricable et montagneux, coupé
de ravins profonds et étroits. Heureusement que l'ennemi, complètement
démoralisé, ne vint pas assaillir nos colonnes qui, avec
des difficultés et des fatigues considérables, mirent plusieurs
heures pour reprendre leurs places initiales.
Le Fort l'Empereur, que surmonte de nos jours l'obélisque élevé
à la gloire de l'armée d'Afrique, est un gros château
fort dont le canon tenait en respect la kasbah et la ville. Aussi le dey
en avait-il confié le commandement au Khasnadji, ministre des Finances,
l'homme le plus résolu de son gouvernement. Largement approvisionné,
il était armé de 53 pièces et sa garnison comptait
2.000 hommes.-
-
En face de lui, le camp de siège français formait un quadrilatère
irrégulier sur le plateau d'El Biar, le long de la voie romaine.
La longue ligne de l'armée occupait les hauteurs.
Sept batteries furent construites à une distance moyenne de 600
mètres du château pour en battre la face sud et la corne
sud-ouest. Pendant ces travaux, la lutte d'infanterie continuait sur les
positions mêmes.
Le 1er juillet, la flotte fit une démonstration, défilant
à extrême portée de canon, mais sans grand résultat
de part et d'autre. Elle revint quelques jours plus tard sans plus de
succès.
Cependant, le cercle des assiégeants se resserrait. Le maréchal
de camp baron Achard, commandant la 20 brigade de la I" division,
avait déjà occupé la pointe Pescade avec le (4e d'infanterie
(colonel d'Armaillé). Le 3 juillet, les batteries de siège
étaient prêtes.
Le lendemain, à l'aube, le bombardement commença. L'artillerie
ennemie, bien que supérieure en nombre et servie avec un courage
admirable par des artilleurs turcs, ne pouvait résister à
la nôtre, plus précise et plus meurtrière. Le tir
croisé de nos batteries faisait sauter les épaulements en
maçonnerie, écrouler les parapets, derrière lesquels
apparaissaient en pleine vue les canons et leurs servants. Les corps des
canonniers jonchaient les remparts.
Vers 8 heures, quelques pièces ennemies se turent et l'on vit des
fuyards se sauver par la petite poterne qui fait face à la ville.
Mais, de la kasbah, le dey fit tirer sur ses propres troupes, qui se rejetèrent
dans le fort. A 10 heures, toute l'artillerie algérienne était
réduite au silence et l'on commençait à battre en
brèche le mur sud pour permettre l'assaut de l'infanterie. Visiblement,
la panique s'était mise dans le fort, car, malgré ,le tir
de la kasbah, les soldats turcs s'enfuyaient maintenant vers la ville.
Soudain, à 10 heures et quart, une flamme immense jaillit et une
détonation formidable ébranla toute la terre. La poudrière
sautait. Quittant le fort le dernier, le Khasnadji avait, au moyen d'une
traînée de poudre, mis le feu au donjon.
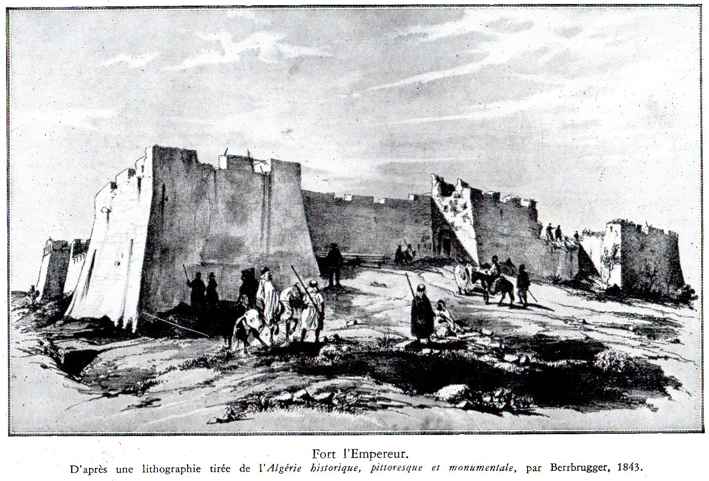 Fort l'Empereur |
Une grêle de pierres vint s'abattre sur la ville et les environs,
heureusement sans grand dommage pour nos hommes, mais causant des pertes
importantes dans Alger.
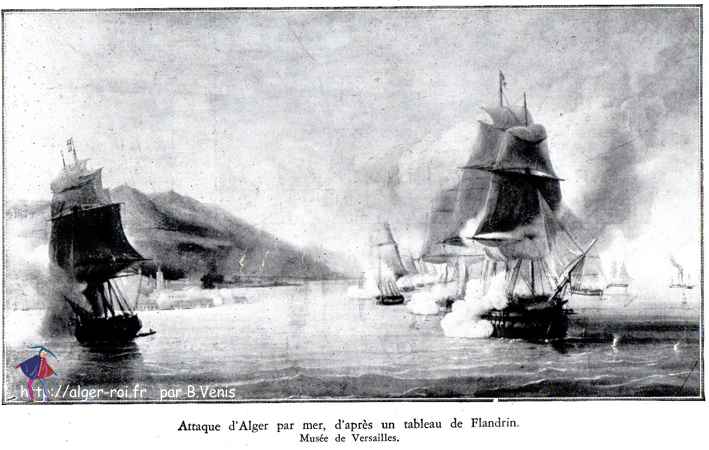 Attaque d'Alger par mer |
Le vieux maréchal de camp baron Hurel, à
la tête du 2e de marche et du 60e de ligne, s'élança
en avant dans la fumée qui enveloppait encore les murs du château.
Un grenadier du 17° d'infanterie escalada le tronc calciné
d'un palmier qui se trouvait dans la cour et y noua sa chemise en guise
de drapeau blanc. A cette vue, une immense clameur emplit le fort et,
se répercutant jusque sur les hauteurs de la Bouzaréa, roula
vers la ville et la rade : la première armée d'Afrique criait
: « Vive le roi ! »
Le sort d'Alger était entre nos mains. A 2 heures de l'après-midi,
Sidi Mustapha, premier secrétaire du dey,vint demander au général
de Bourmont un armistice de la part du dey. « Vous vous rendrez
à merci ou je bombarde la ville », avait répondu Bourmont.
Jamais, - depuis Duquesne, Alger n'avait entendu pareil langage. Le dey
cherchait encore à gagner du temps. Il s'était enfermé
dans la kasbah, pendant que l'émeute grondât autour de lui.
Deux riches commerçants maures étaient venus offrir au général
de Bourmont de lui apporter la tête de Hussein pacha sur un plateau
pour qu'il épargnât la capitale. Le général
les avait chassés avec mépris. Les janissaires eux- mêmes
se révoltaient : Hussein dut céder. Entouré de son
état- major et de tous les généraux de l'armée,
Bourmont dicta lui-même l'acte de reddition que le dey fut forcé
d'accepter.
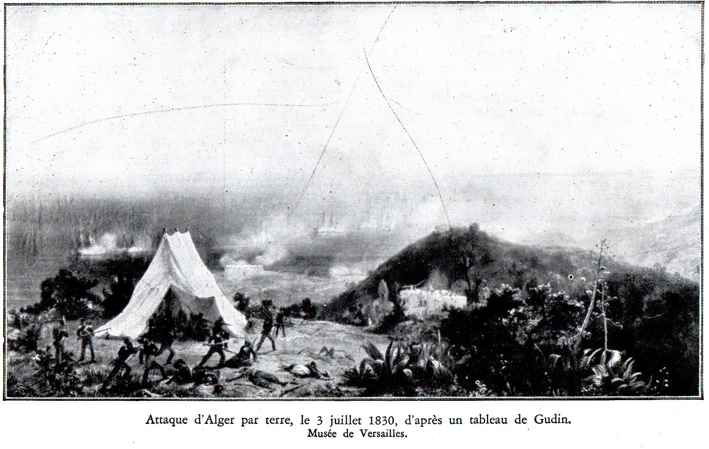 Attaque d'Alger par terre |
Aux termes de l'armistice, la Régence et la ville
se rendaient à merci. Toute l'armée ennemie mettait bas
les armes, tandis que les Français venaient occuper la ville et
les forts, dont le gouvernement était assumé par le commandant
en chef. Celui-ci garantissait, par contre, la vie et la propriété
de tous les habitants, le respect de leurs religions et de leurs sanctuaires.
Il promettait également au dey de ne pas toucher à ses biens
personnels et de mettre à sa disposition un vaisseau de guerre
pour le conduire dans un port neutre.
Le lendemain 5 juillet 183o, à 10 heures du matin, l'armée
française, drapeaux déployés et musique en tête,
entrait à Alger.
Prince SIXTE DE BOURBON.