À propos du décret
Crémieux
Georges Bensadou
Des lecteurs ont dialogué, dans " la chronique
des chercheurs " de l'algérianiste, sur les motivations de
ce décret, sur ses effets: transformation des Juifs de l'Algérie
en Français (1.-M. Manivit, l'algérianiste n° 96, décembre
2001, p. 124), ou naturalisation " en bloc " pour obtenir la
citoyenneté (2.-M. Métras, l'algérianiste n°
98, juin 2002, p. 116), ou bénéfice de la citoyenneté
accordée aux Juifs indigènes de l'Algérie (3.-M.
Accomiato, l'algérianiste n° 102, juin 2003, p. 130), sur l'exclusion,
alors, des Juifs sahariens qui n'en auraient bénéficié
que plus tard et quand? (4.-M. Fonfride, l'algérianiste n°
100, décembre 2002, p. 121, et M. Accomiato précité),
et sur le refus d'en étendre le bénéfice aux Musulmans
(M. Manivit)... Notre ami Georges Bensadou, magistrat honoraire, a bien
voulu rédiger une réponse globale pour clarifier ces questions
et en faire le point.
La législation coloniale de la France
Il faut rappeler que
lorsque la France annexe la Régence turque d'Alger, par la Convention
du 5 juillet 1830, les habitants de la Régence deviennent des nationaux
français.
La législation coloniale de l'époque classe les Français
des colonies en deux catégories :
- celle des Français citoyens qui sont les métropolitains
venus dans la colonie,
- celle des Français indigènes qui comprend les autochtones
du pays, et donc en Algérie, les indigènes musulmans et
les indigènes juifs.
Ces Français indigènes sont des Français de seconde
zone, appelés d'ailleurs bien souvent des " sujets français
": ils ne bénéficient pas des droits publics accordés
aux citoyens, mais ils conservent leurs droits privés à
caractère religieux coraniques ou mosaïques (règles
du mariage, du divorce - polygamie et répudiation, règles
de la filiation, de la majorité, règles de successions...)
au lieu de ceux du Code civil.
Les plus émancipés de ces indigènes pourront
être admis à la qualité de citoyens (droits publics
et droits privés du Code civil) par option personnelle et abandon
de leur droit religieux (sur tous ces points, voir mon article "
Une date à retenir: le 5 juillet 1830 ",
l'algérianiste n° 67, septembre 1994, p. 80 (note
du site : je ne le possède pas.)et le tableau en
annexe 1).
C'est justement l'objet du sénatus-consulte de l'empereur Napoléon
III du 14 juillet 1865 qui rappelle:
- que les indigènes musulmans et israélites sont Français;
- qu'ils peuvent demander, à titre individuel, le bénéfice
de la citoyenneté (texte en annexe II )
Mais... à cette époque,
abandonner sa loi religieuse était, pour les Musulmans comme pour
les Juifs, l'acte d'un renégat, d'un apostat (m'torni). Ce qui
explique l'échec du droit d'option accordé aux indigènes.
Le décret Crémieux
1 - Il
s'agit, en réalité, d'un décret du Gouvernement provisoire
de la Défense nationale (mis en place après la chute de
l'Empire).
Il a été signé le 24 octobre 1870 et publié
au Bulletin officiel de Tours du 7 novembre 1870.
Mais il est d'usage d'appeler ce texte du nom de son initiateur alors
ministre de la Justice et responsable des questions algériennes
: Isaac, Adolphe Crémieux.
Le but du décret était de donner aux misérables et
arriérées masses des Juifs d'Algérie la citoyenneté,
à les obliger ainsi à abandonner loi mosaïque et moeurs
archaïques et donc les inciter à l'émancipation, à
la civilisation. C'était là le voeu des élites juives
de France et des grandes villes d'Algérie.
Il faut insister sur ce point: le décret Crémieux n'a pas
" transformé " ces Israélites en nationaux français,
ce qu'ils étaient déjà depuis le 5 juillet 1830,
mais il a donné à ces indigènes la qualité
de citoyen. Pour s'en convaincre il suffit de lire le texte du décret
(annexe III).
Mais alors, pourquoi tant d'auteurs ont- ils écrit que le décret
avait naturalisé les Israélites, en faisant des Français?
Pour le comprendre il faut se reporter à la législation
coloniale évoquée ci-dessus : deux catégories de
Français : citoyens et indigènes et aucun mot, à
caractère technique, pour désigner le passage de l'indigénat
à la citoyenneté !
Aussi, les auteurs de l'époque ont cherché un terme pouvant
désigner ce changement de statut avec accession à la
citoyenneté. Ils l'ont trouvé, par emprunt à
un mécanisme juridique du même genre: le passage d'étranger
à celle de Français : la " naturalisation ". Ils
ont créé un néologisme, au sens ancien du mot (l'étranger
devient Français) s'ajoute un sens nouveau (l'indigène devient
citoyen). Le mot " naturalisation " est devenu " amphibologique
", c'est-à-dire à double sens, car il est équivoque
(deux significations) et ambigu (incertain); seul le contexte peut en
préciser le sens. D'où l'erreur fréquente qui consiste
à dire qu'il y a eu naturalisation (l'étranger devient Français)
des Juifs. Aussi, vaut-il mieux éviter de parler de naturalisation
des Juifs, même s'il faut écrire (ce qui est plus long):
accession à la citoyenneté (sur ce point, voir le professeur
Louis Milliot, de la Faculté d'Alger dans Les institutions kabyles,
revue des Études islamiques, tome vr, 1932).
2 - Les avatars du décret.
Sous le régime de Vichy, le décret est abrogé le
7 octobre 1940 par décision du maréchal Pétain, et
les Juifs d'Algérie redeviennent des indigènes. Si le général
Giraud décide, le 14 mars 1943, de déclarer nulle la législation
de Vichy, il décide aussi, le même jour d'abroger encore
une fois le décret Crémieux!... Et il faut attendre le 21
octobre 1943 pour voir le Comité français de libération
nationale, présidé par le général De Gaulle,
" constater que le décret Crémieux se trouvait maintenu
en vigueur ".
Les Juifs sahariens
Il s'agit de très anciennes communautés
issues d'autochtones berbères, judaïsées par des Hébreux
aux époques phénicienne (814/146 avant J. - C.) et romaine
(146 avant J. - C./435 après J.-C.) et réfugiées
dans l'Atlas saharien et des oasis (M'Zab - Laghouat - Ouargla - Colomb-
Béchar...).
Le décret précisait qu'il ne bénéficiait qu'aux
" Israélites des départements de l'Algérie
". Or, fin 1870, les Territoires sahariens non encore conquis,
ne faisaient donc pas partie de ces départements. Et les Juifs
sahariens n'en ont alors pas profité.
Mais quand sont-ils devenus des citoyens?
Il y eut controverse sur ce point. N'ont pas été retenues
les dates suivantes: 24 décembre 1902 (loi créant les Territoires
du Sud), et 17 mars 1956 (départementalisation de ces mêmes
territoires) par de nombreux juristes et par l'administration, dont le
choix s'est porté sur le 13 juin 1962 (décret d'homologation
du registre d'état-civil, l'inscription sur ce registre valant
accès au statut civil de droit commun - et donc à la citoyenneté).
Et les Musulmans
La France n'a jamais voulu imposer aux Musulmans
l'abandon de leur statut personnel religieux (loi coranique), ce à
quoi d'ailleurs, ces derniers n'ont jamais voulu consentir. Et ils accéderont
à la citoyenneté tout en conservant leur droit religieux
en vertu de l'ordonnance du 7 mars 1944. Ce n'est donc pas par dépit
que les Kabyles ont déclenché la révolte de 1871.
C'est une légende (cf. Histoire de l'Algérie française,
C. Martin, éd. Tchou, 1979, tome II, p. 241). Cette insurrection
trouve ses causes dans la défaite de l'Empire, signe de faiblesse
de la France pour les indigènes; dans la crainte d'un régime
civil en Algérie pour les chefs féodaux qui ne connaissaient
que l'autorité des militaires, qui craignaient une diminution de
leurs pouvoirs...
À cela s'ajoute la misère après les grandes famines
des années précédentes.
Ce n'est donc pas le décret Crémieux,
ignoré des masses populaires, même s'il a été
mal accueilli par des chefs de tribus qui n'admettaient pas que les Juifs
deviennent des égaux des Français, qui a poussé les
Musulmans à se soulever.
D'ailleurs, quand le chef de l'insurrection, El Moqrani, a vu qu'il n'était
pas suivi dans sa révolte, il a dû faire proclamer la guerre
sainte (par la Confrérie des Rahmaniya) pour être suivi par
les populations de Kabylie et du Constantinois dans la guerre contre les
" Roumis " (8 avril 1871).
Annexe I
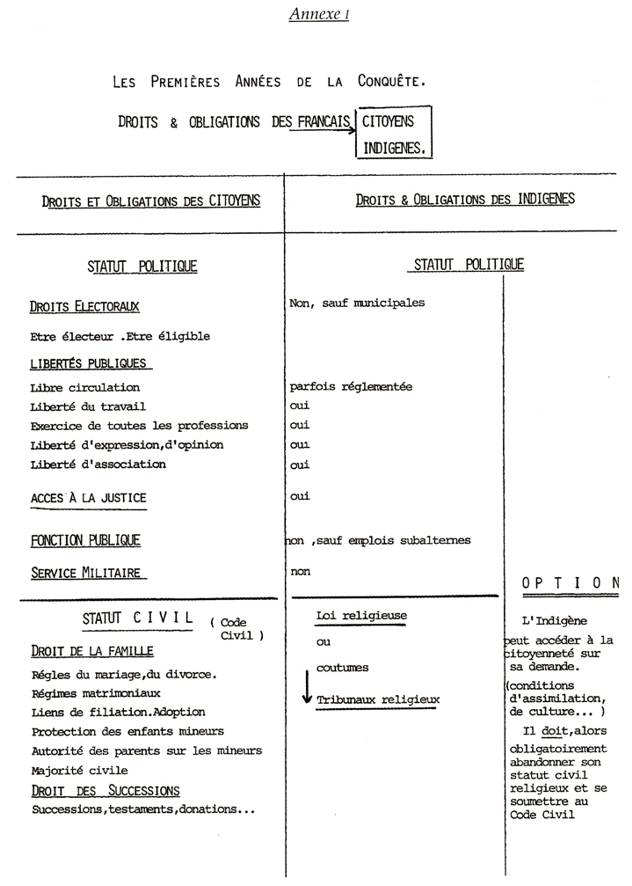
Annexe II
Sénatus-consulte
du 14 juillet 1865 sur l'état des personnes et la naturalisation
en Algérie
(11 Bull. 1315 n° 13-504).
Art. 1er - L'indigène musulman est
français, néanmoins, il continuera à être régi
par la loi musulmane.
Il peut être admis à servir dans les armées de terre
et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et
emplois civils en Algérie.
Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de
citoyen français; dans ce cas, il est régi par les lois
civiles et politiques de la France.
Art. 2 - L'indigène israélite est français néanmoins
il continue à être régi par son statut personnel.
Il peut être admis à servir dans les armées de terre
et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et
emplois civils en Algérie.
Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de
citoyen français; dans ce cas, il est régi par la loi française
(Les art. 2, 4 et 5 ont été
abrogés par le décret du 24 octobre 1870.).
Art. 3 - L'étranger qui justifie de trois années de résidence
en Algérie peut être admis à jouir de tous les droits
de citoyen français.
Art. 4 - La qualité de citoyen français ne peut être
obtenue, conformément aux articles 1, 2 et 3 du présent
sénatus- consulte, qu'à l'âge de vingt et un ans accomplis,
elle est conférée par décret impérial rendu
en Conseil d'Etat (Les art. 2, 4 et
5 ont été abrogés par le décret du 24 octobre
1870.).
Art. 5 - Un règlement d'administration publique déterminera
:
1 - les conditions d'admission, de service et d'avancement des indigènes
musulmans et des indigènes israélites dans les armées
de terre et mer;
2 - les fonctions et emplois civils auxquels les indigènes musulmans
et les indigènes israélites peuvent être nommés
en Algérie;
3 - les formes dans lesquelles seront instruites les demandes prévues
par les articles 1, 2 et 3 du présent sénatus-consulte (Les
art. 2, 4 et 5 ont été abrogés par le décret
du 24 octobre 1870.).
Annexe III
ALGÉRIE, ISRAÉLITES INDIGÈNES,NATURALISATION.
24 oct. - 7 nov. 1870 - Décret qui
déclare citoyens français les israélites indigènes
de l'Algérie (Bull. de Tours, n° 136).
LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE, DÉCRÈTE:
Les israélites indigènes des départements de l'Algérie
sont déclarés citoyens français; en conséquence,
leur statut réel et leur statut personnel seront, à compter
de la promulgation du présent décret, réglés
par la loi française, tous droits acquis jusqu'à ce jour
restant inviolables.
Toute disposition législative, tout sénatus- consulte, décret,
règlement ou ordonnance contraires, sont abolis.
ALGÉRIE, INDIGÈNES MUSULMANS,ÉTRANGERS, NATURALISATION.
24 oct. - 7 nov. 1870 - Décret sur
la naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers
résidant en l'Algérie (Bull. de Tours, n° 137).
LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE, DÉCRÈTE:
Art. 1 - La qualité de citoyen français, réclamée
en conformité des art. 1 et 3 du sénatus- consulte du 14
juillet 1865, ne peut être obtenue qu'à l'âge de 21
ans accomplis.
Les indigènes musulmans et étrangers résidant en
Algérie, qui réclament cette qualité, doivent justifier
de cette condition par un acte de naissance; à défaut, par
un acte de notoriété dressé, sur l'attestation de
quatre témoins, par le juge de paix ou le cadi du lieu de la résidence,
s'il s'agit d'un indigène, et par le juge de paix, s'il s'agit
d'un étranger.
2 - L'art. 10, § 1er, du tit. 3, l'art. 11 et l'art. 14, § 2,
du tit. 4 du décret du 21 avril 1866, portant règlements
d'administration publique, sont modifiés comme il suit:
Tit. 3, art. 10, § 1er: L'indigène musulman, s'il réunit
les conditions d'âge et d'aptitude déterminées par
les règlements français spéciaux à chaque
service, peut être appelé, en Algérie, aux fonctions
et emplois de l'ordre civil désigné au tableau annexé
au présent décret.
Tit. 3, art. 11: L'indigène musulman qui veut être admis
à jouir des droits de citoyen français doit se présenter
en personne devant le chef du bureau arabe de la circonscription dans
laquelle il réside, à l'effet de former sa demande, et de
déclarer qu'il entend être régi par les lois civiles
et politiques de la France. Il est dressé procès-verbal
de la demande et de la déclaration.
Art. 14, § 2: Les pièces sont adressées par l'administration
du territoire militaire du département au gouverneur général.
3 - Le gouverneur général civil prononce sur les demandes
en naturalisation, sur l'avis du comité consultatif.
4 - Il sera dressé un bulletin de chaque naturalisation en la forme
des casiers judiciaires. Ce bulletin sera déposé à
la préfecture du département où réside l'indigène
ou l'étranger naturalisé, même si l'individu naturalisé
réside sur le territoire dit territoire militaire.
5 - Sont abrogés les art. 2, 4 et 5 du sénatus- consulte
du 14 juillet 1865, les art. 13, tit. 4, et 19, tit. 6, intitulé
dispositions générales du décret du 21 avril 1866.
Les autres dispositions desdits sénatus-consulte et décret
sont maintenues.
1.-M. Manivit, l'algérianiste n° 96, décembre
2001, p. 124
Décret Crémieux, autres autochtones. 96/361. Au moment du
décret Crémieux, la décision ou la non décision
concernant les " autres autochtones ", les Algériens
proprement dits : y a-t-il eu des arguments pour décider de transformer
les Juifs en Français, face à d'autres arguments pour ne
pas étendre l'application aux Musulmans?
2.-M. Métras, l'algérianiste n° 98, juin 2002, p. 116
Décret Crémieux, autres autochtones? À l'attention
de Pierre Manivit 84160 Cucuron (l'algérianiste n° 96/361).La
décision de naturalisation des " Israélites indigènes
de l'Algérie " par le décret Crémieux (signé
le 24 octobre 1870 par Gambetta, Crémieux, ministre de la Justice,
Glaise Bizoin et Fourichon, membres de la " Délégation
deTours " et corrélativement celle implicite de ne pas l'étendre
aux " Arabes ", dont les Kabyles), doit s'examiner dans le temps.Dès
1847, M. de Baudicour écrivait dans son livre sur La colonisation
de l'Algérie que le " gouvernement français aurait
un intérêt majeur à s'attacher les Juifs algériens...
". En 1860, Jules Delsieux publiait un Essai sur la naturalisation
collective des Israe7ites indigènes (imprimerie Duclaux, Alger).
En 1864, les Israélites de l'Algérie adressent une pétition
au Sénat à l'effet d'être élevés à
la dignité de citoyen français. Cette même année,
Napoléon III, lors d'une réception officielle au Château
Neuf à Oran, en présence du Grand rabbin et de son consistoire,
déclare: " Bientôt j'espère, les Israe7ites algériens
seront citoyens français... ". Le sénatus-consulte
du 14 juillet 1865, permet, à titre individuel, aux indigènes
israélites ou musulmans, à leur demande, une naturalisation.
Jusqu'en 1870, on ne comptait que 398 naturalisations pour les Israélites,
dont à peine 10 % étaient des Juifs algériens indigènes;
les autres étant marocains ou tunisiens. En 1869, le Conseil général
d'Alger s'exprimait considérant: " que les nombreuses preuves
de patriotisme et les servicesrendus par les Israélites indigènes
commandent impérieusement que le titre de citoyen français
leur soit donné sans retard ".Ainsi le décret Crémieux
ne vient que concrétiser un voeu largement partagé par les
intéressés et les Français. Concrètement,
ce décret ne concernera, à l'époque, que 38000 Israélites.
S'agissant des indigènes arabes (dont les Kabyles), ceux-ci n'ont
jamais été tentés par la possibilité d'acquérir,
à titre individuel, la citoyenneté. Même si le sénatus-consulte
du 14 juillet 1865 facilite leur naturalisation par une procédure
simplifiée (" Pour se faire naturaliser, l'indigène
musulman, sujet français, n'a qu'à se présenter devant
le maire, l'administrateur ou le commandant supérieur, et à
lui déclarer qu'il entend être régi par les lois civiles
et politiques de la France "). Concrètement, au 30 décembre
1895, pendant trente ans et sur une population de 3,5 millions d'hommes,
il n'y eut que 930 naturalisations d'Arabes ou de Kabyles (194 jusqu'en
1870!).
Y avait-il en Algérie en 1870, d'autres communautés d'indigènes,
sujets français (autres que musulmane ou israélite)? Les
étrangers (Espagnols, Italiens...) ne sont guère non plus
attirés par le sénatus-consulte de 1865... Il faudra attendre
la loi 26 juin 1889 pour accélérer le flux des naturalisations...
" forcées " (automaticité). (Sources: Histoire
de l'Algérie, Xavier Yacono, Atlanthrope, 1993; La naturalisation
des Juifs algériens et l'insurrection de 1871,
Louis Forest).
Daniel Métras 78000 Versailles
- De nombreux ouvrages traitent la question du décret Crémieux.
Vous pouvez consulter les huit pages que Charles Taillart lui consacre
dans L'Algérie dans la littérature française, avec
bien sûr de nombreuses références à divers
auteurs et l'analyse sommaire des arguments présentés.
André Gille 83 000 Toulon - Simple remarque concernant les sentiments
personnels de Crémieux, admirateur de Napoléon ler et de
la Révolution française. Dès 1860, il avait lancé
un appel en faveur des maronites, chrétiens persécutés
par les Turcs. Or, à l'époque du décret Crémieux,
Alger gardait encore le souvenir d'un passé oùle Turc était
le maître.
Dr Georges Duboucher 31000 Toulouse
3.-M. Accomiato, l'algérianiste n°
102, juin 2003, p. 130
- Le décret Crémieux? À l'attention de Jacques Fonfride
31000 Toulouse (l'algérianiste n° 100/474).
Le décret du 24 octobre 1870 (dit Crémieux) rendait citoyens
français " les israélites indigènes des départements
d'Algérie ". Une dépêche du 7 novembre 1882,
du ministre de la Justice au ministre de l'Intérieur, citée
en note de renvoi de la reproduction dudit décret (Code de l'Algérie
annoté - 1830 à 1898 - Estoublon et Lefébure, p.
373 et 374, alinéa d) confirme cette limitation géographique
indiquant notamment " une situation d'infériorité marquée
vis-à-vis des indigènes, les Israélites du M'Zab
ne sont en rien préparés pour une naturalisation en bloc
", signalant toutefois que " la situation légale, après
l'occupation, des Israélites résidant actuellement dans
le M'Zab est diversement appréciée ". La dépêche
ministérielle considère que le M'Zab se situe en dehors
des départements de l'Algérie et que les Israélites
y résidant ne peuvent être tenus collectivement comme nationaux
français et que seule une naturalisation individuelle est possible
sur la base du senatus-consulte de 1865. À noter que le décret
du 7 avril 1884, relatif à la représentation des indigènes
musulmans dans les conseils municipaux, précise en son article
1 que la population européenne servira seule à déterminer
la composition, en ce qui concerne les membres français, des conseils
municipaux. Un commentaire à cette disposition, figurant dans le
Code précité, indique qu'une circulaire du Gouverneur général
du 15 avril 1884 (que je ne possède pas) souligne que les Israélites
français, au sens du décret, doivent être considérés
comme faisant partie de cette population européenne. La lecture
du livre d'André Chouraqui, Histoire des Juifs d'Afrique du Nord,
nous rappelle que, même la loi du 20 septembre 1947 portant statut
organique de l'Algérie, maintenait les Juifs du M'Zab dans le deuxième
collège. L'auteur considère qu'ils ne bénéficièrent
du décret Crémieux qu'au moment de la départementalisation
des " Territoires du Sud " (cf. p. 322, note 51) soit, selon
moi, en 1957 (création des départements des Oasis et de
la Saoura). Cette courte analyse permettra, je l'espère, d'éclairer
davantage le sujet, étant observé combien un mot (département)
ou une phrase a d'importantes conséquences dans un texte législatif
ou réglementaire.
Rolland Accommiato 83130 La Garde
4.-M. Fonfride, l'algérianiste n° 100, décembre
2002, p. 121, et M. Accomiato précité
Décret Crémieux, autres autochtones? À l'attention
de Pierre Manivit 84 130 Cucuron (l'algérianiste n° 96/361),
en complément de la réponse collégiale de MM. Daniel
Métras, Georges Duboucher et André Gille (l'algérianiste
n° 99, p. 116 et 117).
Seuls les Juifs résidant dans les trois départements d'Alger,
Oran et Constantine ont bénéficié de cette naturalisation
collective. Ceux qui résidaient en dehors, à savoir dans
ce qu'on appelait alors les Territoires du Sud, ont été
exclus.
Jacques Fonfride 33 000 Bordeaux