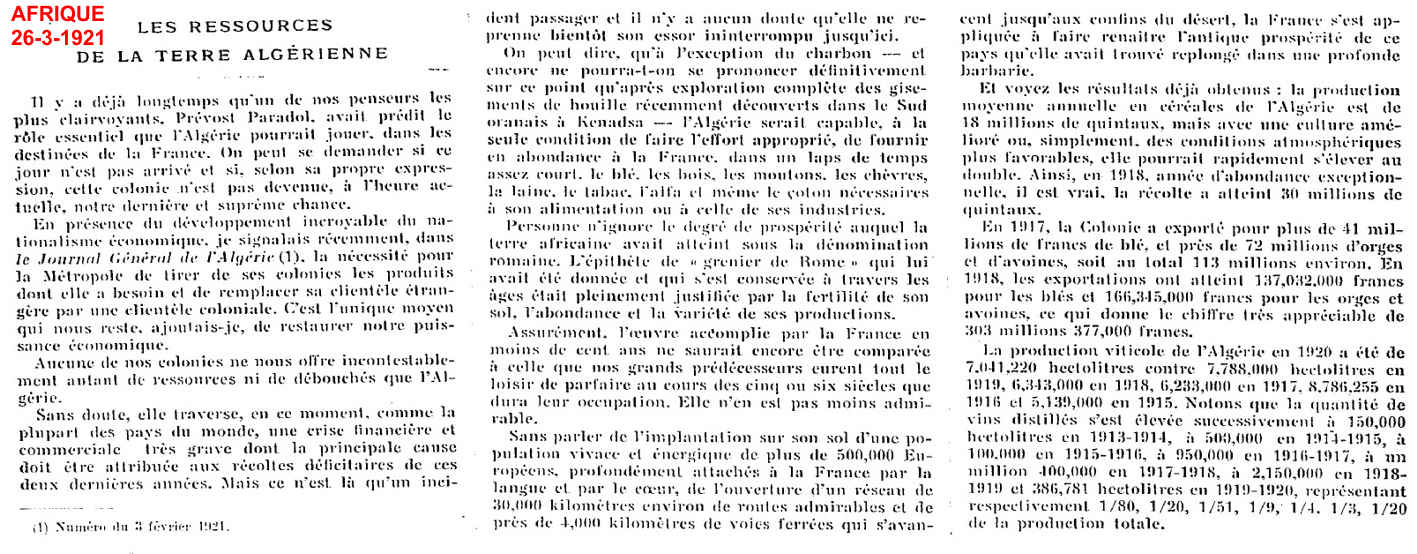
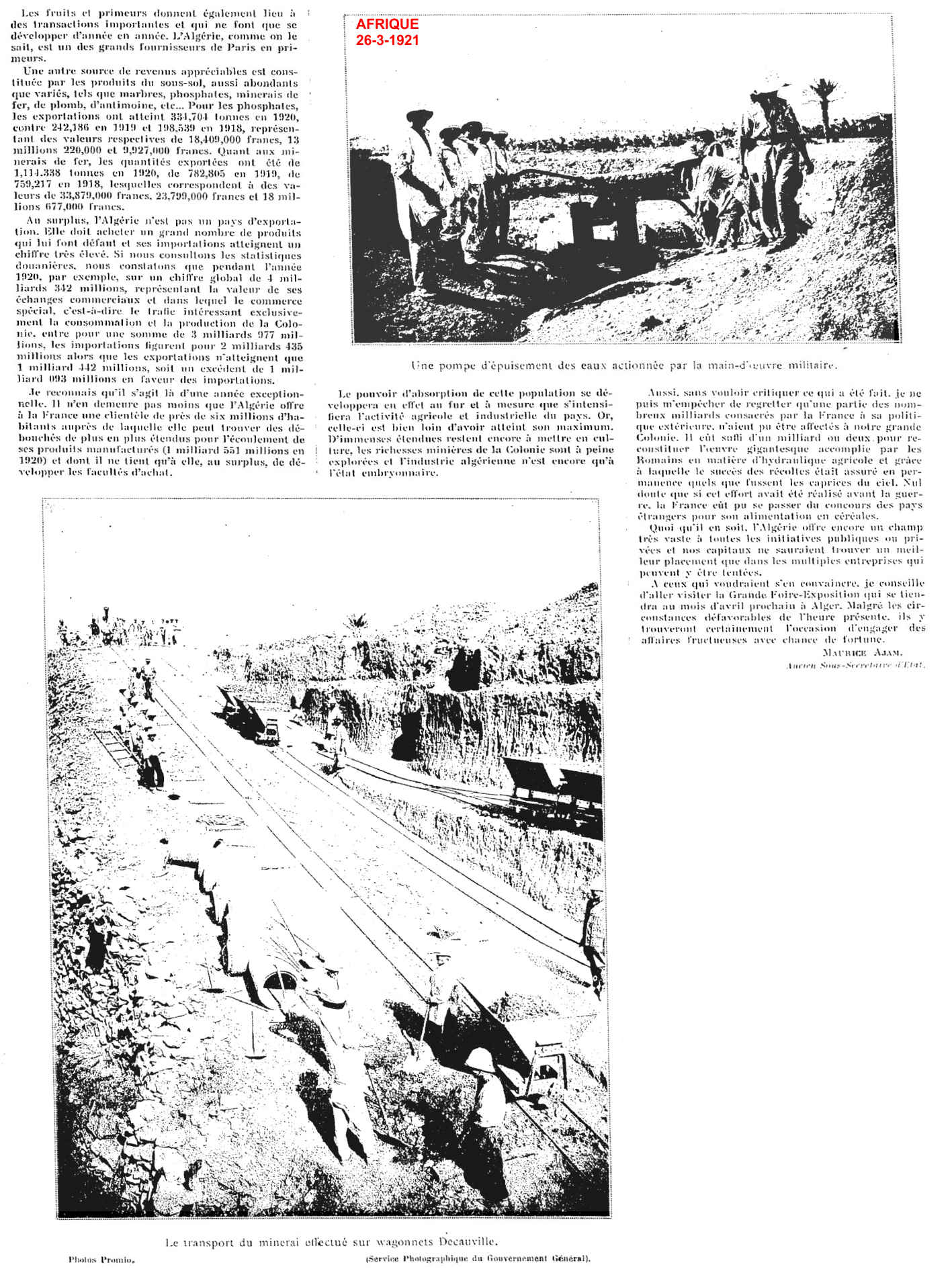
LES RESSOURCES DE LA TERRE
ALGÉRIENNE
Il y a déjà
longtemps qu'un de nos penseurs les plus clairvoyants, Prévost
Paradol. avait prédit le rôle essentiel que l'Algérie
pourrait jouer, dans les destinées de la France. On peut se demander
si ce jour n'est pas arrivé et si, selon sa propre expression,
cette colonie n'est pas devenue, à l'heure actuelle, notre dernière
et suprême chance.
En présence du développement incroyable du nationalisme
économique, je signalais récemment, dans le Journal Général
de l'Algérie, la nécessité pour la Métropole
de tirer de ses colonies les produits dont elle a besoin et de remplacer
sa clientèle étrangère par une clientèle
coloniale. C'est l'unique moyen qui nous reste, ajoutais-je, de restaurer
notre puissance économique.
Aucune de nos colonies ne nous offre incontestablement autant de ressources
ni de débouchés que l'Algérie.
Sans doute, elle traverse, en ce moment, comme la plupart des pays du
monde, une crise financière et commerciale très grave
dont la principale, cause doit être attribuée aux récoltes
déficitaires de ces deux dernières années. Mais
ce n'est là qu'un incident passager et il n'y a aucun doute qu'elle
ne reprenne bientôt son essor ininterrompu jusqu'ici.
On peut dire, qu'à l'exception du charbon - et encore ne pourra-t-ou
se prononcer définitivement sur ce point qu'après exploration
complète des gisements de houille récemment découverts
dans le Sud oranais à Kenadsa - l'Algérie serait capable,
à la seule condition de faire l'effort approprié, de fournir
en abondance à la France, dans un laps de temps assez court,
le blé, les bois, les moutons, les chèvres, la laine,
le tabac, l'alfa et même le coton nécessaires à
son alimentation ou à celle de ses industries.
Personne n'ignore le degré de prospérité auquel
la terre africaine avait atteint sous la dénomination romaine.
L'épithète de " grenier de Rome " qui lui avait
été donnée et qui s'est conservée, à
travers les âges était pleinement justifiée par
la fertilité de son sol, l'abondance et la variété
de ses productions.
Assurément, l'œuvre accomplie par la France en moins de
cent ans ne saurait encore être comparée à celle
que nos grands prédécesseurs eurent tout le loisir de
parfaire au cours des cinq ou six siècles que dura leur occupation.
Elle n'en est pas moins admirable.
Sans parler de l'implantation sur son sol d'une population vivace et
énergique de plus de 500.000 Européens, profondément
attachés à la France par la langue et par le cœur,
de l'ouverture d'un réseau de 30.000 Kilomètres environ
de routes admirables et. de près de 4.000 kilomètres de
voies ferrées qui s'avancent s'avancent jusqu'aux confins du
désert, la France s'est appliquée à faire renaître
l'antique prospérité de ce pays qu'elle avait trouvé
replongé dans une profonde barbarie.
Et voyez les résultats déjà obtenus : la production
moyenne annuelle en céréales de l'Algérie est de
18 millions de quintaux, mais avec une culture amélioré
ou, simplement, des conditions atmosphériques plus favorables,
elle pourrait rapidement s'élever au double. Ainsi, en 1918.
année d'abondance exceptionnelle, il est vrai, la récolte
a atteint 30 millions de quintaux.
En 1917, la Colonie a exporté pour plus de 41 millions de francs
de blé, et près de 72 millions d'orges et d'avoines, soit
au total 113 millions environ. En 1918, les exportations ont atteint
137.032.000 francs pour les blés et 166,345.000 francs pour les
orges et avoines, ce qui donne le chiffre très appréciable
de 303 millions 377.000 francs.
La production viticole de l'Algérie en 1920 a été
de 7.041.220 hectolitres contre 7.788.000 hectolitres en 1919, 6.343.000
en 1918, 6.233.000 en 1917, 8.786.255 en 1916 et 5.139.000 en 1915.
Notons que la quantité de vins distillés s'est élevée
successivement à 150.000 hectolitres en 1913-1914, à 500.000
en 1914-1915, à 100.000 en 1915-1916, à 950.000 en 1916-19l7,
à un million 400,000 en 1917-1918, à 2.150.000 en 1918-1919
et 386,781 hectolitres en 1919-1020, représentant respectivement.
1/80, 1/20, 1/51, 1/9, 1/4, 1/3, 1/20 de la production totale.
Les fruits et primeurs donnent également lieu à des transactions
importantes et qui ne font que se développer d'année en
année. L'Algérie, comme on le sait, est un des grands
fournisseurs de Paris en primeurs.
Une autre source de revenus appréciables est constituée
par les produits du sous-sol, aussi abondants que variés, tels
que marbres, phosphates, minerais de fer, de plomb, d'antimoine, etc.
Pour les phosphates, les exportations ont atteint 334.704 tonnes en
4920, contre 242.186 en 1919 et 198.539 en 1918, représentant
des valeurs respectives de 18.409.000 francs, 13 millions 220.000 et
9.927.000 francs. Quant aux minerais de fer, les quantités exportées
ont été de 1.114.338 tonnes en 1920, de 782.805 en 1919,
de 759.217 en 1918, lesquelles correspondent à des valeurs de
33.879.000 francs, 23.799.000 francs et 18 millions 677.000 francs.
Au surplus, l'Algérie n'est pas un pays d'exportation. Elle doit
acheter un grand nombre de produits qui lui font défaut et ses
importations atteignent un chiffre très élevé.
Si nous consultons les statistiques douanières, nous constatons
que pendant l'année 1920, par exemple, sur un chiffre global
de 4 milliards 342 millions, représentant la valeur de ses échanges
commerciaux et dans lequel le commerce spécial, c'est-à-dire
le trafic intéressant exclusivement la consommation et la production
de la Colonie, entre pour une somme de 3 milliards 977 millions, les
importations figurent pour 2 milliards 435 millions alors que les exportations
n'atteignent que 1 milliard 442 millions, soit un excédent de
1 milliard 093 millions en faveur des importations.
Je reconnais qu'il s'agit là d'une année exceptionnelle.
Il n'en demeure pas moins que l'Algérie offre à la France
une clientèle de près de six millions d'habitants auprès
de laquelle elle peut trouver des débouchés de plus en
plus étendus pour l'écoulement de ses produits manufacturés
(1 milliard 551 millions en 1920) et dont il ne tient qu'à elle,
au surplus, de développer les facultés d'achat.
Le pouvoir d'absorption de cette population se développera en
effet au fur et à mesure que s'intensifiera l'activité
agricole et industrielle du pays. Or, celle-ci est bien loin d'avoir
atteint son maximum. D'immenses étendues restent encore à
mettre en culture, les richesses minières de la Colonie sont
à peine explorées et l'industrie algérienne n'est
encore qu'à l'état embryonnaire.
Aussi, sans vouloir critiquer ce qui a été fait, je ne
puis m'empêcher de regretter qu'une partie des nombreux milliards
consacrés par la France à sa politique extérieure,
n'aient pu être affectés à notre grande Colonie.
Il eût suffi d'un milliard ou deux pour reconstituer l'œuvre
gigantesque accomplie par les Humains en matière d'hydraulique
agricole et grâce à laquelle le succès des récoltes
était assuré en permanence quels que fussent les caprices
du ciel. Nul doute que si cet effort avait été réalisé
avant la guerre, la France eût pu se passer du concours des pays
étrangers pour son alimentation en céréales.
Quoi qu'il en soit, l'Algérie offre encore un champ très
vaste à toutes les initiatives publiques ou privées et
nos capitaux ne sauraient trouver un meilleur placement que dans les
multiples entreprises qui peuvent y être tentées.
A ceux qui voudraient s'en convaincre, je conseille d'aller visiter
la Grande Foire-Exposition qui se tiendra au mois d'avril prochain à
Alger. Malgré les circonstances défavorables de l'heure
présente, ils y trouveront certainement l'occasion d'engager
des affaires fructueuses avec chance de fortune