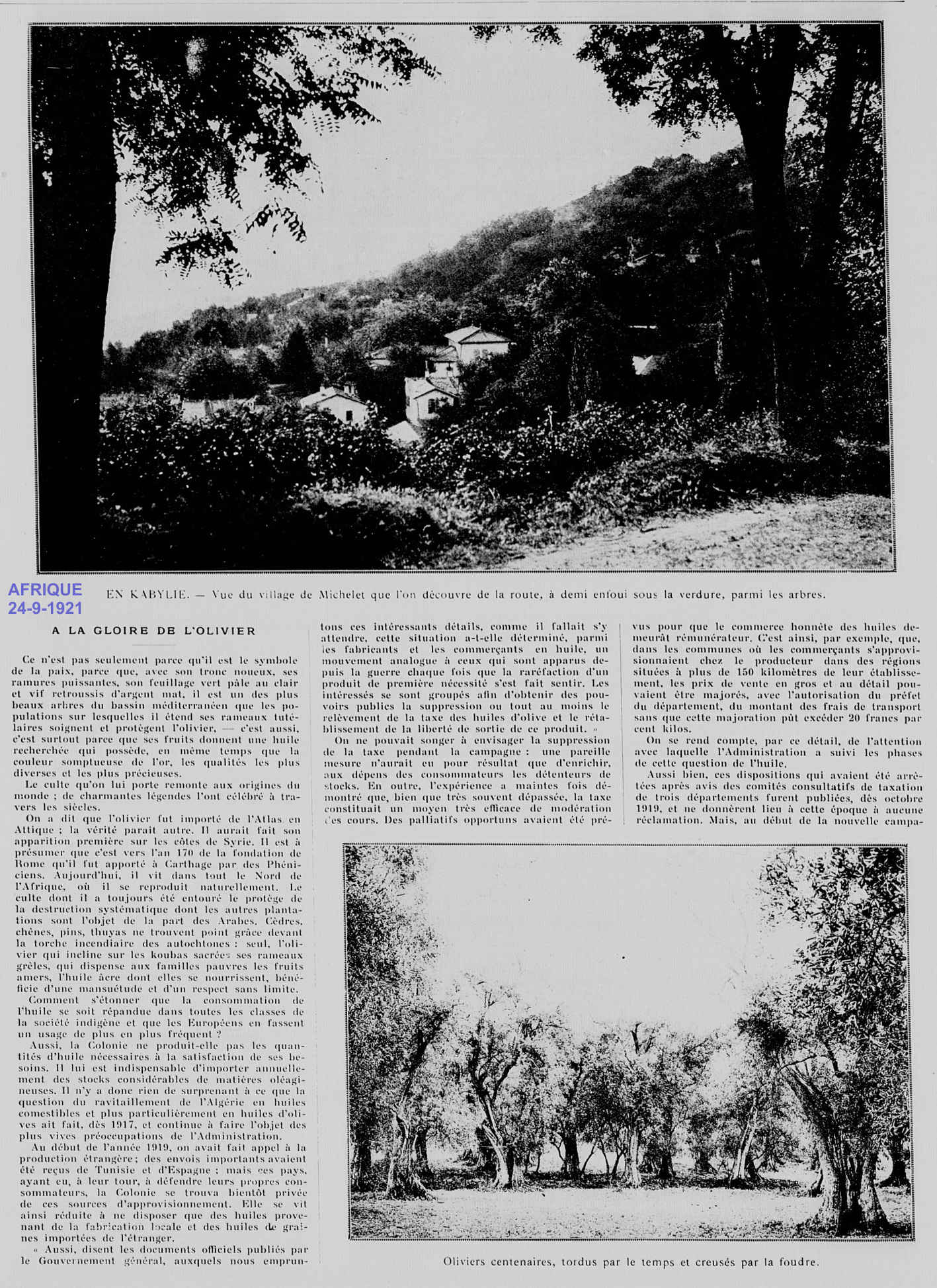
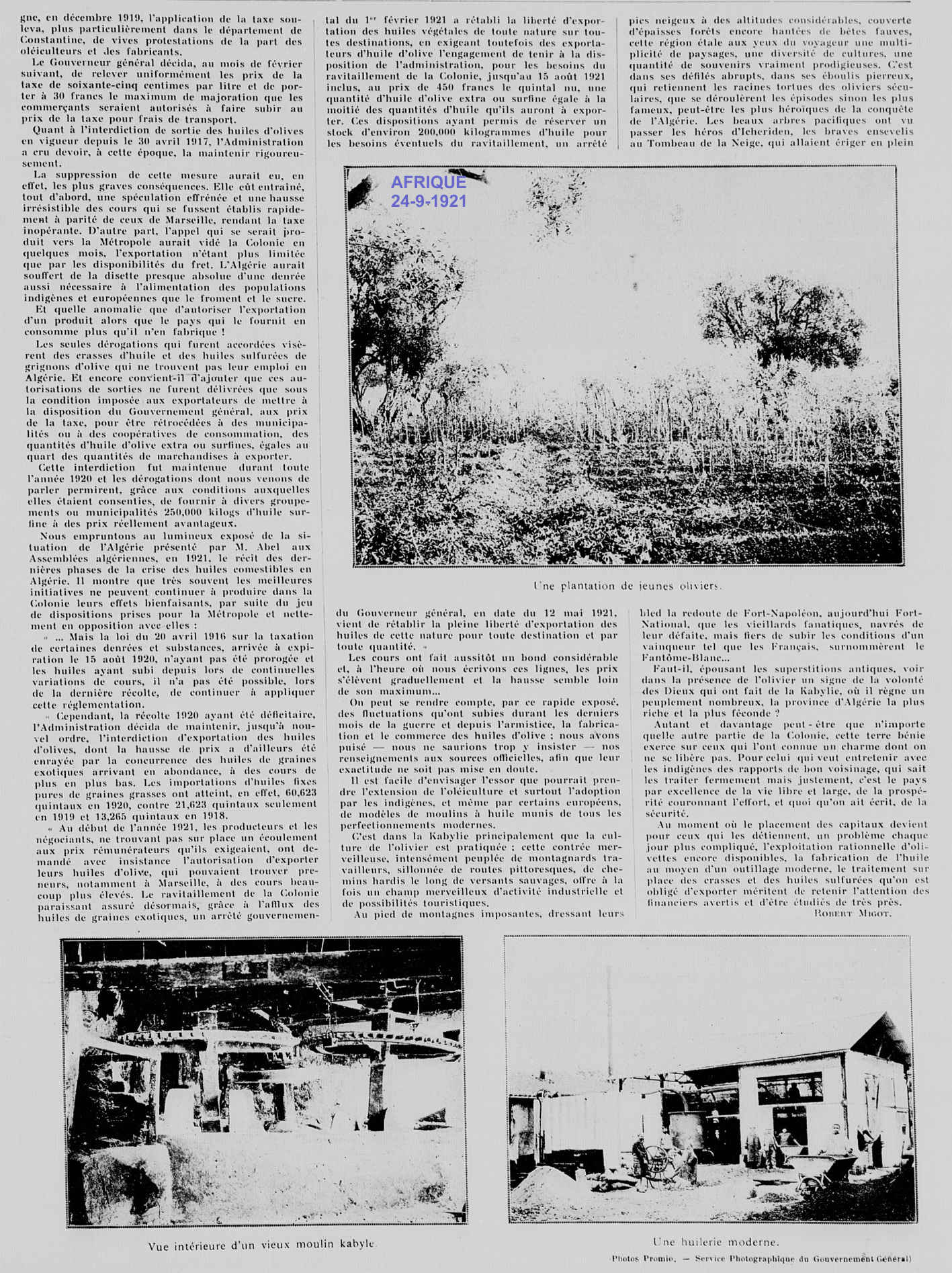 A
LA GLOIRE DE L'OLIVIER
A
LA GLOIRE DE L'OLIVIER
Ce n'est pas seulement
parce qu'il est le symbole de la paix, parce que. avec son tronc noueux,
ses ramures puissantes, son feuillage vert pâle au clair et vif
retroussis d'argent mat, il est un des plus beaux arbres du bassin méditerranéen
que les populations sur lesquelles il étend ses rameaux tutélaires
soignent et protègent l'olivier, c'est aussi, c'est surtout parce
que ses fruits donnent une huile recherchée qui possède,
en même temps que la couleur somptueuse de l'or, les qualités
les plus diverses et les plus précieuses.
Le culte qu'on lui porte remonte aux origines du monde ; de charmantes
légendes l'ont célébré à travers
les siècles.
On a dit que l'olivier fut importé de l'Atlas en Attiquc : la
vérité parait autre. Il aurait fait son apparition première
sur les côtes de Syrie. Il est à présumer que c'est
vers l'an 170 de la fondation de Rome qu'il fut apporte à Cartilage
par des Phéniciens. Aujourd'hui, il vit dans tout le Nord de
l'Afrique, où il se reproduit naturellement. Le culte dont il
a toujours été entouré le protège de la
destruction systématique dont les autres plantations sont l'objet
de la part des Arabes. Cèdres, chênes, pins, thuyas ne
trouvent point grâce devant la torche incendiaire des autochtones
: seul, l'olivier qui incline sur les koubas sacrées ses rameaux
grêles, qui dispense aux familles pauvres les fruits amers, l'huile
acre dont elles se nourrissent, bénéficie d'une mansuétude
et d'un respect sans limite.
Comment s'étonner que la consommation de l'huile se soit répandue
dans toutes les classes de la société indigène
et que les Européens en fassent un usage de plus en plus fréquent
?
Aussi, la Colonie ne produit-elle pas les quantités d'huile nécessaires
à la satisfaction de ses besoins. Il lui est indispensable d'importer
annuellement des stocks considérables de matières oléagineuses.
Il n'y a donc rien de surprenant à ce que la question du ravitaillement
de l'Algérie en huiles comestibles et plus particulièrement
en huiles d'olives ait fait, dès 1917 et continue à faire
l'objet des plus vives préoccupations de l'Administration,
Au début de l'année 1919, on avait l'ait appel à
la production étrangère ; des envois importants avaient
été reçus de Tunisie et d'Espagne ; mais ces pays,
ayant eu, à leur tour, à défendre leurs propres
consommateurs, la Colonie se trouva bientôt privée de ces
sources d'approvisionnement. Elle se vit ainsi réduite à
ne disposer que des huiles provenant de la fabrication locale et des
huiles de graines importées de l'ét ranger.
Aussi, disent les documents officiels publiés par le Gouvernement
général, auxquels nous empruntons ces intéressants
détails, comme il fallait s'y attendre, celte situation a-t-elle
déterminé, parmi les fabricants et les commerçants
en huile, un mouvement analogue à ceux qui sont apparus depuis
la guerre chaque fois que la raréfaction d'un produit de première
nécessité s'est fait sentir. Les intéressés
se sont groupés afin d'obtenir des pouvoirs publics la suppression
ou tout an moins le relèvement de la taxe des huiles d'olive
et le rétablissement de la liberté de sortie de ce produit.
On ne pouvait songer à envisager la suppression de la taxe pendant
la campagne : une pareille mesure n'aurait eu pour résultat que
d'enrichir, aux dépens des consommateurs les détenteurs
de stocks. Eu outre, l'expérience a maintes fois démontré
que, bien que très souvent dépassée, la taxe constituait
un moyen très efficace de modération des cours. Des palliatifs
opportuns avaient été prévus pour que le commerce
honnête des huiles demeurât rémunérateur.
C'est ainsi, par exemple, que, dans les communes où les commerçants
s'approvisionnaient chez le producteur dans des régions situées
à plus de 150 kilomètres de leur établissement,
les prix de vente en gros et au détail pouvaient être majorés,
avec l'autorisation du préfet du département, du montant
des frais de transport sans que celle majoration put excéder
20 francs par cent kilos.
On se rend compte, par ce détail, de l'attention avec laquelle
l'Administration a suivi les phases de cette question de l'huile.
Aussi bien, ces dispositions qui avaient été arrêtées
après avis des comités consultatifs de taxation de trois
départements furent publiées, dès octobre 1919,
et ne donnèrent lieu à cette époque à aucune
réclamation. Mais, au début de la nouvelle campagne, en
décembre 1919, l'application de la taxe souleva, plus particulièrement
dans le département de Constantine, de vives protestations de
la part des oléiculteurs et des fabricants.
Le Gouverneur général décida, au mois de février
suivant, de relever uniformément les prix de la taxe de soixante-cinq
centimes par litre et de porter à 30 francs le maximum de majoration
que les commerçants seraient autorisés à faire
subir au prix de la taxe pour frais de transport.
Quant à l'interdiction de sortie des huiles d'olives en vigueur
depuis le 30 avril 1917, l'Administration a cru devoir, à cette
époque, la maintenir rigoureusement.
La suppression de cette mesure aurait eu, en effet, les plus graves
conséquences. Elle eût entraîné, tout d'abord,
une spéculation effrénée et une hausse irrésistible
des cours qui se fussent établis rapidement à parité
de ceux de Marseille, rendant la taxe inopérante. D'autre part,
l'appel qui se serait produit vers la Métropole aurait vidé
la Colonie en quelques mois, l'exportation n'étant plus limitée
que par les disponibilités du fret. L'Algérie aurait souffert
de la disette presque absolue d'une denrée aussi nécessaire
à l'alimentation des populations indigènes et européennes
que le froment et le sucre. Et quelle anomalie que d'autoriser l'exportation
d'un produit alors que le pays qui le fournit en consomme plus qu'il
n'en fabrique !
Les seules dérogations qui furent accordées visèrent
des crasses d'huile et des huiles sulfurées de grignons d'olive
qui ne trouvent pas leur emploi en Algérie. Et encore convient-il
d'ajouter que ces autorisations de sorties ne furent délivrées
que sous la condition imposée aux exportateurs de mettre à
la disposition du Gouvernement général, aux prix de la
taxe, pour être rétrocédées à des
municipalités ou à des coopératives de consommation,
des quantités d'huile d'olive extra ou surfines, égales
au quart des quantités de marchandises à exporter.
Celte interdiction fut maintenue durant toute l'année 1920 et
les dérogations dont nous venons de parler permirent, grâce
aux conditions auxquelles elles étaient consenties, de fournir
à divers groupements ou municipalités 250,000 kilogs d'huile
surfine à des prix réellement avantageux.
Nous empruntons au lumineux exposé de la situation de l'Algérie
présenté par M. Abel aux Assemblées algériennes,
en 1920, le récit des dernières phases de la crise des
huiles comestibles en Algérie. Il montre que très souvent
les meilleures initiatives ne peuvent continuer à produire dans
la Colonie leurs effets bienfaisants, par suite du jeu de dispositions
prises pour la Métropole et nettement en opposition avec elles
:
" ... Mais la loi du 20 avril 1916 sur la taxation de certaines
denrées et substances, arrivée à expiration le
15 août 1921, n'ayant pas été prorogée et
les huiles ayant subi depuis lors de continuelles variations de cours,
il n'a pas été possible, lors de la dernière récolte,
de continuer à appliquer cette réglementation.
,. Cependant, la récolte 1920 ayant été déficitaire,
l'Administration décida de maintenir, jusqu'à nouvel ordre,
l'interdiction d'exportation des huiles d'olives, dont la hausse de
prix a d'ailleurs été enrayée par la concurrence
des huiles de graines exotiques arrivant en abondance, à des
cours de plus en plus bas. Les importations d'huiles fixes pures de
graines grasses ont atteint, en effet, 60,623 quintaux en 1920, contre
21,623 quintaux seulement en 1919 et 13,265 quintaux en 1918.
.. Au début de l'année 1921. les producteurs et les négociants,
ne trouvant pas sur place un écoulement aux prix rémunérateurs
qu'ils exigeaient, ont demandé avec insistance l'autorisation
d'exporter leurs huiles d'olive, qui pouvaient trouver preneurs, notamment
à Marseille, à des cours beaucoup plus élevés.
Le ravitaillement de la Colonie paraissant assuré désormais,
grâce à l'afflux des huiles de graines exotiques, un arrêté
gouvernemental du 1" février 1921 a rétabli la liberté
d'exportation des huiles végétales de toute nature sur
toutes destinations, en exigeant toutefois des exportateurs d'huile
d'olive l'engagement de tenir à la disposition de l'administration,
pour les besoins du ravitaillement de la Colonie, jusqu'au là
août 1921 inclus, au prix de 451 francs le quintal nu, une quantité
d'huile d'olive extra ou surfine égale à la moitié
des quantités d'huile qu'ils auront à exporter. Ces dispositions
ayant permis de réserver un stock d'environ 200 000 kilogrammes
d'huile pour les besoins éventuels du ravitaillement, un arrêté
du Gouverneur général, en date du 12 mai 1921. vient de
rétablir la pleine liberté d'exportation des huiles de
cette nature pour toute destination et par toute quantité.
Les cours ont l'ait aussitôt un bond considérable et, à
l'heure où nous écrivons ces lignes, les prix s'élèvent
graduellement et la hausse semble loin de son maximum...
On peut se rendre compte, par ce rapide exposé, des fluctuations
qu'ont subies durant les derniers mois de la guerre et depuis l'armistice,
la fabrication et le commerce des huiles d'olive : nous avons puisé
- nous ne saurions trop y insister - nos renseignements aux sources
officielles, afin que leur exactitude ne soit pas mise en doute.
Il est facile d'envisager l'essor que pourrait prendre l'extension de
l'oléiculture et surtout l'adoption par les indigènes,
et même par certains européens, de modèles de moulins
à huile munis de tous les perfectionnements modernes.
C'est dans la Kabylie principalement que la culture de l'olivier est
pratiquée : cette contrée merveilleuse, intensément
peuplée de montagnards travailleurs, sillonnée de routes
pittoresques, de chemins hardis le long de versants sauvages, offre
à la fois un champ merveilleux d'activité industrielle
et de possibilités touristiques.
Au pied de montagnes imposantes, dressant leurs pics neigeux à
des altitudes considérables, couverte d'épaisses forêts
encore hantées de bêtes fauves, cette région étale
aux yeux du voyageur une multiplicité de paysages, une diversité
de cultures, une quantité de souvenirs vraiment prodigieuses.
C'est dans ses défilés abrupts, dans ses éboulis
pierreux, qui retiennent les racines tordues des oliviers séculaires,
que se déroulèrent les épisodes sinon les plus
fameux, peut-être les plus héroïques de la conquête
de l'Algérie. Les beaux arbres pacifiques ont vu passer les héros
d'Icheriden, les braves ensevelis au Tombeau de la Neige, qui allaient
ériger en plein bled la redoute de Fort-Napoléon, aujourd'hui
Fort-National, que les vieillards fanatiques, navrés de leur
défaite, mais licrs de subir les conditions d'un vainqueur Ici
que les Français, surnommèrent le Fantôme-Blanc...
Faut-il, épousant les superstitions antiques, voir dans la présence
de l'olivier un signe de la volonté des Dieux qui ont fait de
la Kabylie, où il règne un peuplement nombreux, la province
d'Algérie la plus riche et la plus féconde ?
Autant et davantage peut-être que n'importe quelle autre partie
de la Colonie, cette terre bénie exerce sur ceux qui l'ont connue
un charme dont on ne se libère pas. Pour celui qui veut entretenir
avec les indigènes des rapports de bon voisinage, qui sait les
traiter fermement mais justement, c'est le pays par excellence de la
vie libre et large, de la prospérité couronnant l'effort,
et quoi qu'on ait écrit, de la sécurité.
Au moment où le placement des capitaux devient pour ceux qui
les détiennent, un problème chaque jour plus compliqué,
l'exploitation rationnelle d'olivettes encore disponibles, la fabrication
de l'huile au moyen d'un outillage moderne, le traitement sur place
des crasses et des huiles sulfurées qu'on est obligé d'exporter
méritent de retenir l'attention des financiers avertis et d'être
étudiés de très près.