*** La qualité médiocre
des photos de cette page est celle de la revue. Nous sommes ici en 1924.
Amélioration notable plus tard, dans les revues à venir.
" Algeria " en particulier.
N.B : CTRL + molette souris = page plus ou moins grande
TEXTE COMPLET SOUS L'IMAGE.
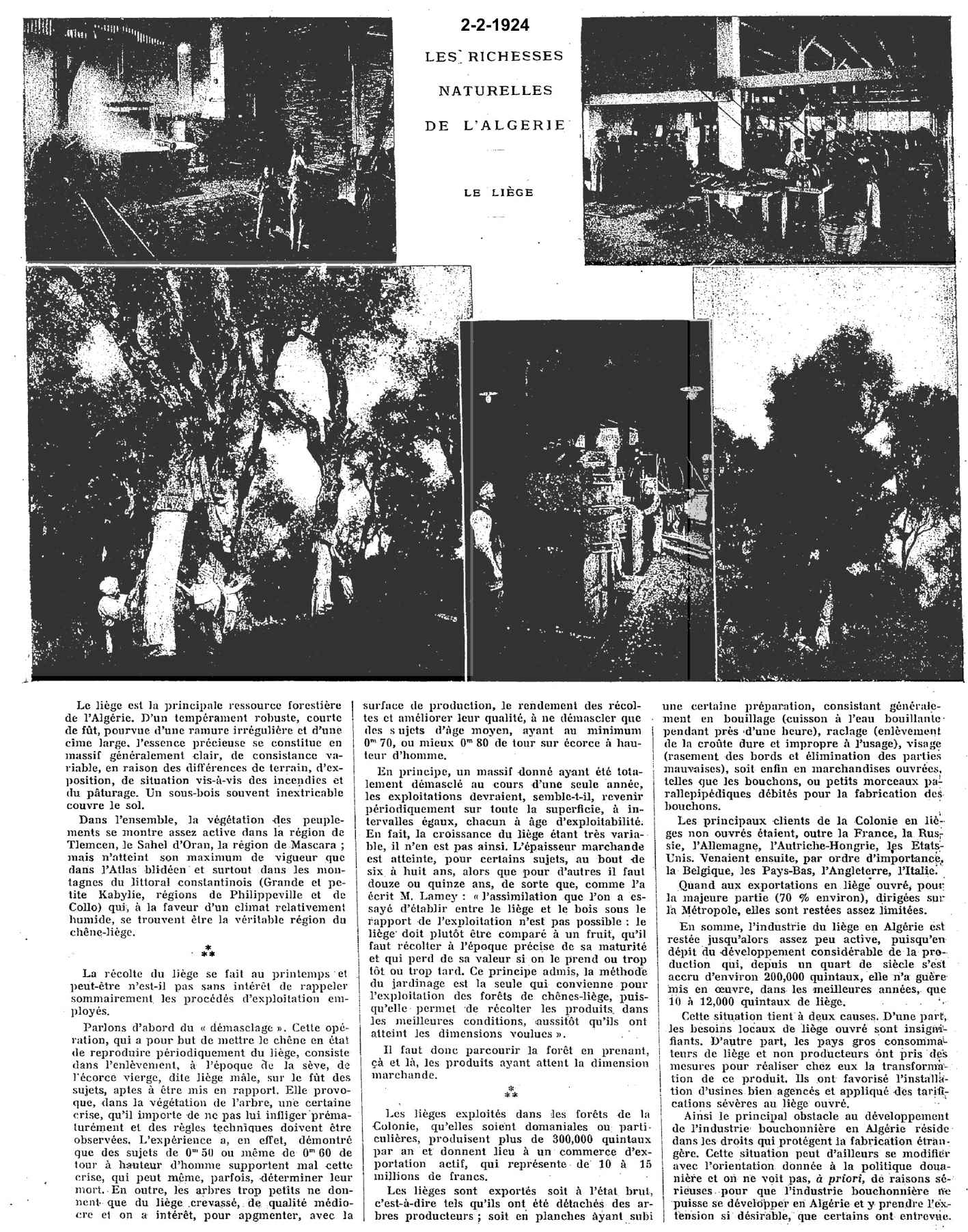 LE
LIÈGE
LE
LIÈGE
Le liège est la
principale ressource forestière de l'Algérie. D'un tempérament
robuste, courte de fût, pourvue d'une ramure irrégulière
et d'une cime large, l'essence précieuse se constitue en massif
généralement clair, de consistance variable, en raison
des différences de terrain, d'exposition, de situation vis-à-vis
des incendies et du pâturage. Un sous-bois souvent inextricable
couvre le sol.
Dans l'ensemble, la végétation des peuplements se montre
assez active dans la région de Tlemcen, le Sahel d'Oran, la région
de Mascara ; mais n'atteint son maximum de vigueur que dans l'Atlas
blidéen et surtout dans les montagnes du littoral constantinois
(Grande et petite Kabylie, régions de Philippeville et de Collo)
qui, à la faveur d'un climat relativement humide, se trouvent
être la véritable région du chêne-liège.
La récolte du liège se fait au printemps et peut-être
n'est-il pas sans intérêt de rappeler sommairement les
procédés d'exploitation employés.
Parlons d'abord du " démasclage". Cette opération,
qui a pour but de mettre le chêne en état de reproduire
périodiquement du liège, consiste dans l'enlèvement,
à l'époque de la sève, de l'écorcé
vierge, dite liège mâle, sur le fût des sujets, aptes
à être mis en rapport. Elle provoque, dans la végétation
de l'arbre, une certaine crise, qu'il importe de ne pas lui infliger
prématurément et des règles techniques doivent
être observées, L'expérience a, en effet, démontré
que des sujets de 0 m 50 ou même de 0 m 60 de tour à hauteur
d'homme supportent mal cette crise, qui peut même, parfois, déterminer
leur mort. En outre, les arbres trop petits ne donnent que du liège
crevassé, de qualité médiocre et on a intérêt,
pour augmenter, avec la surface de production, le rendement des récoltes
et améliorer leur qualité, à ne démascler
que des sujets d'âge moyen, ayant au minimum 0 m 70, ou mieux,
0 m 80 de tour sur écorce à hauteur d'homme.
En principe, un massif donné ayant été totalement
démasclé au cours d'une seule année, les exploitations
devraient, semble-t-il, revenir périodiquement sur toute la superficie,
à intervalles égaux, chacun à âge d'exploitabilité.
En fait, la croissance du liège étant très variable,
il n'en est pas ainsi. L'épaisseur marchande est atteinte, pour
certains sujets, au bout de six à huit ans, alors que pour d'autres
il faut douze ou quinze ans, de sorte que, comme l'a écrit M.
Lamey : " l'assimilation que l'on a essayé d'établir
entre le liège et le bois sous le rapport de l'exploitation n'est
pas possible : le liège doit plutôt être comparé
à un fruit, qu'il faut récolter à l'époque
précise de sa maturité et qui perd de sa valeur si on
le prend ou trop tôt où trop tard. Ce principe admis, la
méthode du jardinage est la seule qui convienne pour l'exploitation
des forêts de chênes-liège, puisqu'elle permet de
récolter les produits dans les meilleures conditions, aussitôt
qu'ils ont atteint les dimensions voulues ".
Il faut donc parcourir la forêt en prenant, çà et
là, les produits ayant atteint la dimension marchande.
Les lièges exploités dans les forêts de la Colonie,
qu'elles soient domaniales ou particulières, produisent plus
de 300.000 quintaux par an et donnent lieu à un commerce d'exportation
actif, qui représente de 10 à 15 millions de francs.
Les lièges sont exportés soit à l'état brut,
c'est-à-dire tels qu'ils ont été détachés
des arbres producteurs ; soit en planches ayant subi une certaine préparation,
consistant généralement en bouillage (cuisson à
l'eau bouillante pendant près d'une heure), raclage (enlèvement
de la croûte dure et impropre à l'usage), visage (rasement
des bords et élimination des parties mauvaises), soit enfin en
marchandises ouvrées, telles que les bouchons, ou petits morceaux
parallélépipédiques débités pour
la fabrication des bouchons.
Les principaux clients de la Colonie en lièges non ouvrés
étaient, outre la France, la Russie, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie,
les États-Unis. Venaient ensuite, par ordre d'importance, la
Belgique, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Italie.
Quand aux exportations en liège ouvré, pour la majeure
partie (70 % environ), dirigées sur là Métropole,
elles sont restées assez limitées.
En somme, l'industrie du liège en Algérie est restée
jusqu'alors assez peu active, puisqu'on dépit du développement
considérable de la production qui, depuis un quart de siècle
s'est accru d'environ 200.000 quintaux, elle n'a guère mis en
œuvre, dans les meilleures années, que 10 à 12.000
quintaux de liège.
Cette situation tient à deux causes. D'une part, les besoins
locaux de liège ouvré sont insignifiants. D'autre part,
les pays gros consommateurs de liège et non producteurs ont pris
des mesures pour réaliser chez eux la transformation de ce produit.
Ils ont favorisé l'installation d'usines bien agencés
et appliqué dés tarifications sévères au
liège ouvré.
Ainsi le principal obstacle au développement de l'industrie bouchonnière
en Algérie réside dans les droits qui protègent
la fabrication étrangère. Cette situation peut d'ailleurs
se modifier avec l'orientation donnée à la politique douanière
et on ne voit pas, a priori, dé raisons sérieuses pour
que l'industrie bouchonnière ne puisse se développer en
Algérie et y prendre l'extension si désirable, que certains
ont entrevue.